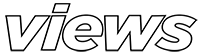En rencontrant Green Montana, nous espérons résoudre une énigme. Sa musique laissant entrevoir un spleen immuable, personne ne sait face à qui nous allons passer l’après-midi. Cette proposition douce-amère, minutieusement travaillée, fait le succès sonore du rappeur belge.
Loin de son image de loup solitaire, Green Montana débarque en meute. À ses côtés, on retrouve son manager Stan, chaleureux et loquace. Il y a également Six, son creative director, discret, tout en restant à l’affût. John est également présent, comme depuis le début de l’aventure. Et enfin, Green. Charismatique sans trop en faire, le natif de Verviers brise rapidement la glace. Le rythme effréné des journées promo a eu raison des forces de la délégation belge : avant de parler, il va falloir déjeuner.
Au sol, les sacs de shopping côtoient les emballages papier d’Uber Eats. Des burgers, des frites et quelques boissons énergisantes trônent sur la table, transformant notre studio en véritable lieu de vie et d’échanges. Calme, sûr de sa force, Green Montana se débarrasse de son paquet de cigarettes et s’installe au milieu de la pièce. Très vite, son équipe l’entoure. Nous voici face à lui et face à eux, dans une configuration proche d’une table ronde. Il est temps de s’attaquer à l’une des plus belles énigmes du rap francophone.

Tu as un jour déclaré : “Mon tempérament est en contradiction avec mes objectifs : je veux percer, mais je n’aime pas trop me montrer.” Tu es toujours en phase avec ça ?
Je travaille cet aspect de ma personnalité. C’est un combat contre moi-même et contre mes propres restrictions. Je veux tellement percer que c’est à moi de changer et d’y aller, en continuant de travailler.
Ces restrictions, tu te les imposes depuis le début de ta carrière ? Voire avant ?
Je suis quelqu’un de réservé, même si je reste sociable et à l’aise avec les autres. Ce qu’il se passe est nouveau, je découvre une nouvelle façon de voir les choses. Au début, c’est difficile d’appréhender que des inconnus sachent qui tu es. Il n’y a pas de retour en arrière possible.
C’est conciliable d’être sur le devant de la scène et de ne pas trop s’exposer pour toi ?
Je dois changer, car où je veux aller, je dois me montrer et être à l’aise avec ça. Au début, je voulais être le plus anonyme et laisser parler uniquement la musique. Là, j’ai compris que c’était un tout. Tout s’apprend, tu peux devenir à l’aise dans tout. C’est qu’une question de temps et je sais que ça va aller.
Tu aurais pu être un personnage totalement anonyme, façon Daft Punk ?
Au début, je ne voulais même pas faire d’interview, ni même montrer ma tête ! Mais si tu peux faire quelque chose avec ta tête, il faut le faire. On était d’accord pour ne pas se montrer, puis le rap a évolué. Le public s’intéresse beaucoup à la personne et à qui elle est.
Dans « Licepo » qui concluait Alaska, tu dis : “Je t’ai dit qu’on préférait être détesté.” Tu te nourris de ce statut autoproclamé de mal-aimé ?
De fou. Je ne trouve même pas que je sois détesté, ma musique est bien reçue. C’est important d’avoir des haters, parce qu’ils te donnent envie de faire fermer des gueules. S’il n’y a que des gens qui te disent : “C’est cool, continue comme ça”… Il n’y a aucun challenge.
Est-ce que tu lis tout ce qu’il se dit sur toi ?
Je lis ça à fond, pour le moment. Mais je vais arrêter ! Une critique ne va jamais m’atteindre personnellement, qu’elle soit construite ou pas. Tout le monde a un avis.
Tu viens de Verviers en Belgique, tu peux nous présenter ta ville ?
Verviers, c’est dans la province de Liège, une petite ville de 50 000 habitants. On est assez proche des artistes de Liège. C’est encore nouveau ce qu’il se passe là-bas. Avant ça, il y avait déjà du rap, mais le rap belge n’en était pas encore au stade actuel. Il y avait déjà des entrepreneurs dans la musique, mais maintenant les planètes sont alignées. Petit à petit, les rappeurs de Verviers vont sortir en pagaille.
Ça ressemblait à quoi de grandir là-bas ?
C’est petit, donc tout le monde se connait un peu. À un moment, je suis parti pour mes études, je suis revenu et ça n’avait pas trop changé. C’est une ville que j’aime bien, mais malheureusement il ne s’y passe pas grand-chose… Ça stagne. Il y a plus de criminalité que de choses positives pour se développer. C’est un endroit compliqué et les gens le savent. C’est une mentalité différente.

Comment décrirais-tu cette mentalité ?
Les gens n’ont pas envie de se mélanger, c’est un entre-soi. À Bruxelles, j’ai l’impression qu’ils voient aussi les gens d’ailleurs de façon bizarre. Mais à Verviers, c’est encore pire.
Le fait de venir d’un territoire qui n’est pas très identifié dans le rap t’a inspiré ?
Chaque endroit a sa sonorité. À Bruxelles ça sonne comme ça, à Paris ça sonne comme ça, à Lyon ça sonne comme ça, à Marseille ça sonne comme ça… À Liège, il y a un truc différent de Bruxelles dans la musicalité. C’est important d’avoir une couleur différente, un peu unique, à nous.
C’était quoi tes références musicales en grandissant à Verviers ?
On écoutait beaucoup de rap français, on a vu toutes les étapes du rap français. À un moment, on s’est rendu compte qu’il y avait moyen de faire un bail quand tous les artistes belges ont commencé à exploser. Après, je ne te mens pas, on a toujours écouté beaucoup de rap américain. En Belgique, de manière générale, ça écoute beaucoup de rap américain. Culturellement, on n’a pas vraiment l’école du rap français. Quand tu grandis en France, tu as toute une bibliothèque musicale française. En Belgique on n’avait pas tout ça. On est un pays bizarre, où ça parle deux langues différentes, où tu retrouves des inspirations différentes.
C’était prévu de revenir aussi vite après Alaska, ton premier album sorti cet automne ?
La musique se consomme assez rapidement et il ne faut pas trop traîner pour sortir des choses. Un délai de six mois, c’est préférable. De la musique tous les six mois, deux projets par an.

Tu avais été satisfait des retours sur Alaska ?
Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient aussi bons. Quand je vais sur Twitter, je vois que ça en parle encore six mois après. Mes réseaux ont pris en followers, un vrai cap a été passé.
Ce succès t’a mis une pression supplémentaire pour Melancholia999 ?
Non, au contraire. Je suis plus à l’aise maintenant. Ça m’a libéré. Alaska, c’était une pression de fou. C’était le premier album, une tension de fou. Quand c’est sorti, on était tous soulagés. On a bien géré ça, parce que je suis très bien entouré. Là, je suis confiant.
Quand tu dis « on », qui est-ce que ça englobe ?
J’ai toujours quelqu’un avec moi au studio, mais je travaille aussi depuis chez moi. J’aime bien travailler tout seul quand c’est juste sur la musique. Mais je m’oblige à envoyer ce que je fais à mon équipe, pour avoir leurs retours. Sans ça, je suis dans le flou. J’ai besoin qu’on soit d’accord.
Ce sont eux les premiers à entendre les sons et à te donner un avis ?
Toujours.
Ça arrive que vous ne tombiez pas d’accord ?
La dernière fois, j’enregistre un son vite fait et j’ai l’impression qu’il est super chaud. Je le fais écouter à Six (son creative director, assis juste à côté de lui, ndlr) et il me fait : “Mouais” (rires). Quand j’ai réécouté le son, je ne le voyais plus pareil. Mon équipe m’influence de fou. C’est important de ne pas être toujours d’accord, parce que depuis le début, je ne fais pas ça tout seul. Quand on sélectionne le single ou la tracklist, c’est des choix de groupe. Je ne peux pas me braquer sur un truc et ne pas les écouter.
L’inverse est déjà arrivé ? Tu n’étais pas du tout convaincu par un son et ton entourage t’a poussé à le sortir ?
Il y a un son que je voulais enlever d’Alaska, que Six m’a dit de ne pas sauter. Et s’il me dit de ne pas le virer, je ne le vire pas.
C’était quoi ?
Six : C’était “J’ROULE”. Il y a aussi “SALE TCHOIN”, que tu ne voulais pas sortir au début… On a un recul sur sa musique qu’il n’a pas forcément.
Green Montana : Ah ouais, pour moi “SALE TCHOIN” ça ne devait pas sortir. Tout le monde m’a poussé là-dessus.
Six : C’est un track que tu n’écoutes toujours pas d’ailleurs.
Green Montana : De manière générale, je n’écoute pas mes sons.

Tu n’es pas au mix du tout par exemple ?
On me les envoie, mais je ne suis pas en train de bosser à côté de l’ingé son. On me propose des mix et ça part. Je fais juste ce que j’ai à faire en cabine.
Il ne faut pas que tu réfléchisses trop à ta musique ?
Green Montana : Si je reste trop longtemps sur un morceau, j’ai l’impression que je calcule. Ça devient des maths dans ma tête.
Six : Je vais lui demander comment il veut que ça sonne et ce qu’il veut faire. On va faire un prétravail, jusqu’à mettre en œuvre la vision qu’il a en tête, puis lui faire écouter pour voir si ça va dans le bon sens. On partage aussi les idées bien sûr.
Green Montana : Les mix, c’est surtout Six. J’ai une totale confiance en son oreille. Quand j’envoie une maquette, elle sonne déjà un peu comme je veux. Je sais qu’il va nettoyer et harmoniser ça, pour que ça sonne comme on l’imagine depuis le début.
Vous bossez ensemble depuis le début ?
Green Montana : Oui, il est quasiment tout le temps avec moi au studio, à toutes les sessions.
Six : Sur chaque projet on discute beaucoup en amont de la couleur et de l’orientation que ça doit prendre. À partir du moment où on est d’accord sur ça, Green fait la musique et moi j’essaie de l’orienter dans la direction définie. Et après, on valide tous ensemble.
Tu parlais de « SALE TCHOIN » qui est un hit, dans le même registre on peut aussi penser à “TOUT GÂCHER” avec Booba ou “Évidemment” avec SDM. Tu n’as pas peur que le public s’arrête à ces morceaux et n’aillent pas découvrir l’intégralité d’un projet ?
Je me fie à ma façon de réfléchir… Si j’aime le son d’un artiste, je vais chercher un autre son de lui, encore un et encore un. Je suis quelqu’un de curieux et je pense que tout le monde l’est aussi. Si tu accroches à quelque chose, tu vas forcément aller voir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être déçu, mais il n’y a qu’une minorité de gens qui se cantonnent à un single dansant et qui ne vont pas voir plus loin.
Selon toi, c’est une bonne porte d’entrée d’avoir des singles très forts ?
Il faut éduquer l’auditeur… Arriver avec un format lisible, pour l’emmener vers un format moins lisible. L’oreille va peu à peu s’habituer aux formats moins lisibles.
Tu dirais que tu es exigeant avec tes auditeurs ?
Je ne dis pas du tout que je fais de la musique plus compliquée qu’un autre, attention ! Je n’articule pas, je murmure même par moment. Quand tu écoutes un son américain et que tu ne parles pas anglais, si tu l’écoutes 100 fois, tu sauras chanter tout un couplet en anglais, sans comprendre. C’est la même chose que j’aimerais pousser.
Est-ce que tu peux nous parler de la direction artistique de ton nouveau projet ? On aime beaucoup la pochette.
On kiffait l’image de l’astronaute qui tombe dans l’espace. L’espace, c’est l’infini, il n’y a pas de limites. Musicalement, ça va aller loin.
C’est ambitieux !
C’est audacieux, même prétentieux (rires) ! Je n’ai pas encore le niveau que je souhaite atteindre, ça se travaille… Tu dois faire plus chaque jour. C’est quelque chose auquel j’aspire.
Comment vous définissez cette direction artistique ? C’est le même process de travail que pour la musique, en étant à plusieurs ?
Green Montana : On parle tous les jours entre nous, on s’envoie des inspi’, des idées en continu. On peut réutiliser des idées qui datent d’il y a six mois, parce qu’on ne les a pas oubliées. On est tout le temps en avance, on prévoit toujours les choses.
Six : On essaie de voir venir, on fonctionne vraiment en projet. Par exemple quand on a fait Alaska, on avait déjà discuté de Melancholia999. On a deux personnalités différentes. Green est dans l’instantané. De mon côté, je suis quelqu’un qui fait plus de plans, qui trace des directions.

Tu t’éclates plus dans la partie vision ?
Green Montana : Tu peux carrément l’appeler la Vision (rires) !
Six : En gros moi je le vois comme ça : Green c’est un peu CR7 et je suis un peu Sir Alex.
Tu es un artiste qui met énormément ses sentiments en avant. Il y a d’autres artistes qui t’ont donné cette envie ?
Un Kanye évidemment, mais aussi Trippie Redd. Ce concept de “Thug Love” me parle. Même dans le rap français ça se faisait à l’ancienne, cette idée d’amour d’un voyou. On a tous des sentiments. Tu peux parler de ta vie, mais il y a toujours un moment où une meuf passe. Tu peux être n’importe qui, une meuf va te marquer. Et là, c’est fini. Je ne sais pas si j’en parlerai, mais je trouve ça intéressant. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas aller trop loin, mais c’est bien de s’ouvrir.
Quand tu dis qu’il ne faut pas aller trop loin, ça t’arrive de te mettre des barrières ?
Maintenant, je ne me pose plus pour écrire. Je pense à une phrase et je la cale. C’est un procédé très spontané. Quand je réécoute, ça m’arrive de revenir sur une phrase et de me dire que ça ne va pas.
C’est important pour toi cette spontanéité ?
Quelque chose me passe par la tête, je le mets. Quand tu écris, il n’y a pas de fautes, c’est net et sans bavure. C’est mieux maintenant, il y a une petite spontanéité en plus. Je vais direct devant le micro, je fais peut-être deux mesures, je réfléchis, je fume un peu, j’enregistre quatre mesures, et ainsi de suite, jusqu’à avoir le son.
Tu es l’une des têtes connues du 92i. Quelle est l’ambiance entre les différents artistes du label ?
Il n’y a pas de groupe WhatsApp comme une classe ou quoi (rires). On se parle tous entre nous, on entretient des bons liens.
Même si on y retrouve beaucoup d’artistes différents, vous partagez quand même une philosophie commune ?
Bien sûr, on est tous dans la piraterie. On est des ambitieux qui ne lâchent rien et qui ne laissent rien. Tout prendre, tout piller. Par la force.

Et justement, quelle place occupe Booba dans la gestion quotidienne du 92i ?
Il est partout, il est même là en ce moment (rires). Tout ce que je fais, je lui envoie et je lui demande son avis. C’est un très bon directeur artistique. Il sait toujours me dire : “Ça, c’est un single”, “Ça, c’est un son d’album“… Il sait mettre une étiquette sur tous les sons, en visant dans le mille à chaque fois. Booba te laisse beaucoup de liberté, tu fais ta musique comme tu le sens. Il t’envoie des productions sur lesquelles il te verrait bien. À l’inverse, je lui envoie des trucs que j’ai bien kiffés et il me fait ses retours.
Comment tu as vécu sa fin de carrière avec ULTRA ?
Déjà, il n’a pas fini (rires). Il est toujours là, et à mon avis pour longtemps. ULTRA, j’ai kiffé de ouf. Pour moi, c’est le meilleur projet français de l’année. C’est du costaud, fidèle à lui-même. C’est précis, tu sens toute son expérience. Tout le monde a eu un petit pincement au cœur quand il a dit que c’était le dernier album. La petite larme, carrément. Mais tu vois ce que j’ai kiffé, c’est qu’il n’arrête pas.
La longévité de Booba, sa carrière monumentale, son rôle de patron du 92i, c’est quelque chose qui t’inspire pour la suite ?
J’en rêve. C’est la meilleure carrière qu’il y aura dans l’histoire du rap français. En termes de rap en France, il a pulvérisé les gens. Aux States, c’est plus grand, tu peux avoir un JAY-Z ou un Drake où ça va aller encore plus loin. Mais pour moi Booba, c’est un gars à ce niveau. Il explose au moins la moitié des artistes américains en termes de carrière. Il les détruit. Sans te mentir, si tu me dis que je peux faire le même chemin, je signe direct. C’est le meilleur exemple que tu puisses avoir si tu veux créer et construire quelque chose dans la musique. Il faut suivre ses pas.

CRÉDITS
Photos : Alexandre Mouchet (@alex_mouchet)
Assistant photo : Tony Raveloarison (@tony.r3)
Stylisme : Selim Moundy (@selimmoundy)
Interview : Julien Perocheau (@julienperocheau)