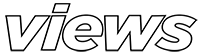S’il ne cache pas sa fatigue d’enchaîner la promotion, « je pourrais faire l’interview en mandarin », Sami Bouajila ne manque plus d’énergie lorsqu’il s’agit de raconter dans le détail sa passion du cinéma. L’acteur récompensé deux fois aux Césars retrace une carrière de plus de 30 ans, nourrie par la découverte avec son père des films de Sergio Leone, puis par le théâtre dans ce qu’il considère être sa “colonne vertébrale”.
Depuis ses débuts en 1991, Sami Bouajila est devenu un acteur de référence du cinéma d’auteur français. Il brille dans des rôles intimistes tels que son dernier projet, “Les Miens” de Roschdy Zem, mais aussi dans des films à succès, comme Braqueurs (2016) ou Indigènes (2006), preuve de sa capacité à se sublimer sur tous les terrains. La juste récompense pour un interprète qui se donne corps et âme à sa discipline.
Tu as découvert le cinéma avec ton père dans ta jeunesse. Il t’emmenait voir quel genre de films ?
Mon père était un cinéphile autodidacte. Il regardait des films basiques, mais c’était du grand cinéma quand même ! Je retiens surtout les westerns de Sergio Leone, comme Il était une fois dans l’Ouest. À l’époque, dans les cinémas, il y avait un film qui était diffusé avant le long-métrage principal, et tu pouvais revoir la séance plusieurs fois. Les salles étaient grandioses, avec l’orchestre, la fosse et le balcon. La projection se faisait en cinémascope, c’était magnifique. Mon père nous emmenait aussi regarder les films de Bruce Lee, de kung-fu.
Quelles ont été tes influences en grandissant ?
Il y en a beaucoup. Je suis devenu cinéphile assez tôt, à l’adolescence. Je construisais moi-même ma culture cinématographique. Lors de sa création, Canal+ diffusait les films en version originale, et des films d’auteurs qu’ils soient français ou américains. Mais même avant cela, j’avais déjà commencé à regarder des films. Je pourrais citer Dustin Hoffman comme inspiration. J’ai presque envie de mettre de côté les éternels Al Pacino et Robert De Niro qui sont incontournables.
Au cinéma, le regard du spectateur se matérialise dans la caméra. Elle vient chercher ton émotion, et il faut surtout apprendre à la laisser venir. La caméra est d’une froide objectivité et le son vient entendre ton âme et ton intimité.
Tu as découvert le jeu par le théâtre. C’est une expérience qui t’a servi dans ta carrière d’acteur ?
Je ne saurai pas dire. En tout cas, c’était mon école à moi, qui m’a donné ma colonne vertébrale. L’expression au théâtre n’est pas la même qu’au cinéma. Au cinéma, le regard du spectateur se matérialise dans la caméra. Elle vient chercher ton émotion, et il faut surtout apprendre à la laisser venir. La caméra est d’une froide objectivité et le son vient entendre ton âme et ton intimité. À l’inverse, au théâtre, c’est l’espace qui sacralise le lieu. Le corps prend une autre ampleur. Les intentions s’expriment à travers le mouvement. Lorsqu’on bouge, on raconte quelque chose. Après, le fond reste le même. Il s’agit d’aller chercher l’authenticité du personnage et de la situation.
Avant de devenir acteur, tu as fait sport-étude, et un CAP de tourneur. Tu n’étais pas sûr de devenir acteur ?
À cette époque-là, je n’avais aucune vocation d’acteur. Après le CAP tourneur, je commençais à me déniaiser, et à prendre conscience qu’il fallait que je trouve un moyen de me réinsérer socialement. Comme je nageais, j’ai passé un brevet d’étude en natation. Puis, comme je ne voulais pas faire le service militaire, j’avais opté pour l’objection de conscience, ce qui me laissait du temps. Je ne sais plus trop comment, je suis entré dans un atelier qui était très bon, puis au conservatoire régional et enfin une école nationale.

C’est difficile de s’imaginer acteur lorsqu’on vient d’un milieu populaire de province ?
C’est la part de rêve qui est en chacun d’entre nous, qu’il faut se permettre. Il y a aussi l’éducation qui intervient. J’ai grandi dans l’amour, et mes parents nous ont toujours incité à aller au devant de nos rêves, même s’ils leur échappaient. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais et ils n’ont jamais vu mes films. Ils ont toujours été mes premiers supporters, même sans voir mon travail.
En 1991, tu obtiens ton premier rôle au cinéma dans La Thune, tu as des souvenirs de ce tournage ?
Oui, c’était euphorique. Je sortais d’une école où on bouffait du théâtre classique ou contemporain douze heures par jour. Et là, j’arrivais dans une comédie, avec une équipe très sympathique. J’étais un peu déstabilisé, j’avais un peu l’impression d’être en colonie de vacances. C’était vachement bien.
En 1998, tu as eu une expérience particulière en jouant dans un film américain, avec Denzel Washington, réalisé par Edward Zwick.
Oui, c’est le réalisateur de Glory, film pour lequel Denzel a eu un Oscar. Il a aussi fait Blood Diamond et Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. J’ai pris énormément de plaisir à travailler avec Denzel et Annette Bening.
Tu joues le rôle d’un agent-double terroriste palestinien. C’est un premier pas qui t’a plu à Hollywood ?
Bien sûr. J’entrais par la grande porte, si je puis dire. Je le faisais dans de bonnes conditions, c’était un film avec un des plus gros budgets du moment. J’ai découvert l’Amérique comme ça, c’était impressionnant.
Tu as dit que tu n’avais pas eu la patience de continuer à Hollywood, car il aurait fallu “subir les clichés”. Tu es content d’y avoir échappé ?
Je ne le dirais pas comme ça. La question n’est plus si je suis heureux d’avoir évité les clichés. Quand tu es dedans, tu ne disposes pas d’assez de recul. Déjà, ton égo en prend un coup. Ensuite, nous autres, acteurs d’origine maghrébine, nous avons eu tellement de place pour déconstruire notre identité, pour la reconstruire sans se trahir. Il faut trouver notre place et s’épanouir avec la définition de la mixité des autres.

À cette époque, tu as aussi tourné avec Abdellatif Kechiche, sur La Faute à Voltaire, quelle a été ton expérience de tourner avec un réalisateur aussi singulier ?
Il y a d’abord eu la découverte d’un cinéaste majeur. J’en avais conscience parce que j’en avais déjà rencontré quelques-uns. Kechiche avait un lyrisme qui résonnait différemment que celui des autres, car on avait la même culture, la même éducation et le même parcours, finalement. C’est un garçon et un metteur en scène d’une intensité assez troublante, qui a su mener toute la troupe qu’on était, Élodie Bouchez, Aure Atika et moi. Je ne sais plus combien d’heures on tournait par jour, mais on était tellement bien ensemble.
Ce qui était intéressant dans le cinéma français à cette époque, c’est que les financements étaient plus simples donc les productions foisonnaient. Les cinéastes d’auteur de cette période sont des cinéastes majeurs aujourd’hui. Les rencontres se faisaient plus facilement, et j’arrivais à me reconnaître en ces gens. Même si le parcours a été plus sinueux pour nous que pour d’autres, on a trouvé notre place finalement.
Pour Kechiche, le scénario était un “prétexte”. Il laissait beaucoup de place à l’improvisation et à l’accident ?
C’est toujours ainsi avec lui. Il doit faire comme Ken Loach, c’est-à-dire que la veille, il ne sait pas ce qu’il va tourner le lendemain. Il peut venir avec une feuille de papier, un prétexte, et ça part. Il est là son artisanat : savoir filmer une part d’humain qui l’intéresse dans son écriture.
C’est challengeant ou déstabilisant en tant qu’acteur d’être face à cette méthode de travail ?
C’est plus déstabilisant que challengeant. Si tu es à l’aise, il va forcément aller te chercher à un endroit auquel tu ne t’attends pas. C’est une expérience au cours de laquelle chaque créateur, pas seulement acteur, espère pouvoir se surprendre et aller dans un espace nouveau.
Jamais on ne pensait qu’Indigènes allait trouver sa place dans cette société, mais il était attendu et c’était une parole qu’il était nécessaire d’exprimer.
Pour parler de la suite de ta carrière, Indigènes a été un film essentiel. La dimension personnelle du film a été importante ?
C’était particulier parce que ça nous échappait à tous. Jamais on ne pensait que le film allait trouver sa place dans cette société, mais il était attendu et c’était une parole qu’il était nécessaire d’exprimer. Le film a mis la lumière sur notre mémoire collective à tous, en tant que citoyens.
C’est l’une de tes ambitions, même si elle n’est pas forcément déclarée, d’élever les acteurs maghrébins, en cherchant des rôles ambitieux ou qui les glorifient ?
L’objectif est plus noble, plus absolu, il ne se limite pas à nous. Je me dis que je veux porter cette parole d’amour, ce caractère torturé, envers et contre toutes les discriminations, affranchir le regard de tous, et m’inscrire dans le spectacle au sens noble du terme. Et là, les choses évoluent. Chacun puise ce qu’il veut. Mais quand on laisse des traces, on les laisse au sens collectif.
Sur Omar m’a tuer, le fait d’aborder le rôle d’un homme qui existe véritablement, encore vivant, et dont l’affaire a été très médiatisée, t’a fait douter ?
D’abord, pour le challenge. Je n’ai pas voulu rencontrer Omar Raddad. Je l’ai vu une première fois à mon insu, bien avant le lancement du tournage, puis à la fin. Pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas me faire écraser par le mythe, mais je voulais le récréer, et le réinventer. C’était la meilleure façon de servir le projet. L’autre chose qui fait que je n’ai pas hésité, c’est que j’étais en famille ! C’est Roschdy qui réalise et c’est Tessalit qui produit, avec qui on a fait Indigènes et Hors-la-loi.

Tu n’as pas “singé” le personnage comme on le reproche à beaucoup d’acteurs lors de biopics.
Non, je voulais juste m’inspirer de lui, de sa silhouette et de son “parler”. Après, Roschdy me donnait une liberté, ou c’est plutôt moi qui me fiais à la liberté de son regard. C’est tout.
À l’époque, on t’avait beaucoup questionné sur la symbolique politique du film. Tu avais dit en interview ne pas vouloir “devenir le porte-parole d’une communauté”. C’est quelque chose que tu souhaites souligner encore aujourd’hui, de ne pas politiser davantage ce rôle ?
Évidemment. Ne serait-ce que pour mieux servir la communauté, il faut s’en affranchir pour donner à ce rôle une autre dimension. Tout le monde se reconnaît en quelqu’un qu’il aime. Je suis un fan de Michael Jackson, de James Brown, ou de Bob Marley, et j’aime tout ce qu’ils sont quand je les vois. Pourtant, je ne suis ni Noir, ni rasta. Ce qui compte, c’est la sensibilité, le cœur, l’âme. L’âme !
Sur Un fils, il y avait une dimension assez personnelle dans le rôle. Tu as notamment tourné en Tunisie, où ton père s’était rendu dans sa jeunesse.
Il y a des rôles, quand on lit le scénario et qu’on rentre dans l’alchimie du personnage, on se dit que ce n’est pas possible et que ça n’existe pas. C’est une espèce de coup de théâtre. Quand je lisais le rôle d’Un fils, je me disais qu’il y avait quelque chose qui m’avait échappé. Je suis revenu quelques pages en arrière, lorsque j’ai lu la partie du médecin qui dit « Monsieur, vous n’êtes pas le père », ça m’a fait un choc. J’ai retrouvé cet accident de la lecture lorsque j’ai joué.
Lors de ton discours de victoire aux Césars pour Un fils, tu avais dit : « les rôles nous choisissent plus qu’on ne les choisit », que voulais-tu dire par là ?
Je ne fais pas un film pour le film, je fais de mon métier un art de vivre. Il devient un mode de vie et un artisanat. Quelque part, ton âme et ton inconscient font partie de ce parcours-là. Il y a quelque chose qui t’échappe, ton parcours te ressemble, et les rôles viennent te choisir. Les scénarios arrivent avec une cohérence. Pas tout le temps, mais en règle générale, lorsqu’on structure le parcours, on voit qu’il y a une cohérence.

Dans ton nouveau film Les Miens, tu retrouves Roschdy Zem à la réalisation. À quoi ressemble votre relation personnelle et professionnelle ?
Notre rapport est très rationnel. Je me fais diriger par Roschdy, qui est un partenaire de vie finalement. Depuis 30 ans, on a traversé les mêmes expériences, lui et moi. Ce sont des expériences tellement singulières dans ce métier, surtout lorsqu’on démarre jeune et que tu te dis que c’est ta vie 30 ans après. Donc ça crée des liens et une complicité forte.
Pourquoi tu as été attiré par le rôle de Moussa dans Les Miens ?
La particularité de ce gars. Il est d’une gentillesse inouïe, qui est plutôt taiseux, qui se maîtrise. Et qui, après son trauma, va devenir tout l’inverse, et dire ses quatre vérités à tout le monde sans le moindre filtre.
Tu as désormais 30 ans de carrière derrière toi, tu penses avoir trouvé le « secret » pour durer dans le milieu ?
Je ne saurai pas dire comment il faut faire. Quelque part, pour moi, avec du recul, je pense que c’est parce que j’ai abordé ma carrière avec humilité, et j’ai toujours eu la foi. Au début, tu ne choisis pas tes rôles, ce sont vraiment eux qui te choisissent pour le coup. Est-ce que j’ai réellement choisi Un fils, ou est-ce que c’est Un fils qui m’a choisi ? Et quand on propose un film comme Les Miens, il y a plein de choses qui font que la réponse est acquise.
Photographie & DA : Moïse Luzolo
Assistant light : Félix Devaux et Tony Raveloarison
Coordination artistique et stylisme : Iris Gonzales
Production : Alice Poireau-Metge
Interview : Corentin Saguez