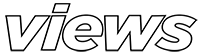Lorsqu’il pénètre dans une pièce, Di-Meh sait occuper l’espace. Solaire, le rappeur engage la discussion avec aisance. Côté style, le dégradé se veut soigné. L’artiste suisse a également renoué avec la sobriété du cheveu brun, après s’être teint un globe terrestre pour la cover de son premier album, Mektoub. Habitué à l’énergie communicative de Di-Meh, son attaché presse rattrape quelques mails en retard, laissant briller l’artiste qu’il défend.
À peine a-t-il eu le temps de poser quelques sacs siglés adidas que Di-Meh se lance dans un éloge du rap marocain. Fier de cette scène en plein renouveau, il nous fait immédiatement écouter un poids lourd local : SNOR. Le plébiscite est total. Le natif de Genève exhibe ensuite son nouveau maillot des Fennecs, soulignant subtilement sa binationalité. “Vous avez un cintre ?” nous questionne sans transition le rappeur, soucieux de conserver l’intégrité de son imposant gilet, une création d’étudiants suisses.
En prenant place face à notre équipe, Di-Meh ne peut s’empêcher de raconter quelques anecdotes sur sa vie à Genève, son terrain de jeu originel. Les minutes défilent et il est temps de commencer notre entretien. Le sérieux revient, l’ambiance se veut terre à terre. Pourtant, notre discussion prendra vite la forme d’un carnet de voyages, sur la trace des souvenirs et du destin de Di-Meh.

Tu écoutais quoi en composant ce nouveau projet ?
J’écoute de tout. Par exemple, la musique brésilienne. Il y a une grosse communauté brésilienne à Genève, j’ai des kheys (amis, ndlr) qui rappent en brésilien, eux, ils m’ont piqué direct par exemple. J’ai mis du baile, du raï, de l’électro, du reggaeton…
En plus de la communauté brésilienne, tu dirais que Genève est un environnement cosmopolite ?
La France a ses immigrations particulières, qui crée votre slang (argot ndlr) français. Ça pioche chez les Maliens, les Sénégalais, les Marocains… En Suisse, on a d’autres origines chez les immigrés, donc tu retrouves d’autres mots. Tu as les Latinos, les Somaliens, les Albanais… Donc on essaie de mixer tout ça en musique. À titre personnel, je me sens proche de toutes ces cultures.
Grandir dans ce milieu pluri-culturel, qu’est-ce que ça t’a apporté humainement ?
Déjà, la langue. Ça m’a permis d’apprendre à en parler plusieurs, de rencontrer beaucoup de gens. Je suis producteur aussi, donc si je trouve une instru de techno allemande que je kiffe, je vais essayer de la reproduire. Une inspi baile funk, on tâte aussi, house pareil, old school, new school, two step, garage… C’est de la chimie, c’est scientifique !

Tu as profité de ces 2 ans de pause pour faire des recherches sur tes ancêtres, sur ton histoire de famille. Quelle était ta démarche précise ?
Comme je suis algéro-marocain, j’ai étudié mon arbre généalogique du côté algérien via mes oncles, mes tantes… J’étais là-dedans et j’ai trouvé des trucs de fou. Ma grand-mère est Kurde, issue de l’immigration turque en Algérie, empire Ottoman tout ça… Je sais qu’elle était Turque et qu’elle était rousse, donc il y a d’autres choses. Je sais que mon grand-père est aussi allé en Europe de l’Est. C’est des choses que j’essaie de retracer, je suis allé jusqu’à mon arrière grand-mère kurde. Parce que par la suite, j’ai su que la principale immigration turque en Algérie était kurde, c’était les gens des montagnes. En gros, ma mère est Kurde de Turquie et mon grand-père est Algérien, côté Oran. Et avant lui, ça venait du désert, avec des origines berbères, soufies. Ensuite, je suis allé voir du côté de ma grand-mère au Maroc, qui est Berbère aussi, avec les tatouages tout ça. Mais je n’avais pas de photos de mon grand-père. Je cherchais, je cherchais, je cherchais… Et là j’ai trouvé : c’était un Afro-marocain.
Quand tu connais l’histoire de ta famille, tu prends conscience de la réalité des choses.
Di-Meh
A quel moment tu as eu ce déclic pour lancer ces recherches ?
C’est quand je suis allé au Bénin, avec Slimka et Varnish la Piscine. C’est le pays du vaudou, il y aussi une grosse culture musicale. J’ai fait de la scène là-bas avec un band béninois, qui est en place depuis 30 ans. Ils jouent beaucoup sur les percussions et je voyais le public en état de transe. L’état transique m’a rappelé mon père, mon grand-père, quand ils se trouvent dans des états comme ça en priant. On est allé voir la Porte du Non-Retour à Ouidah. Ça m’a choqué. À partir de là, j’ai voulu retracer mon histoire familiale.
Q’est-ce que tu en as tiré humainement de ce travail de mémoire ?
C’est important de connaître son histoire. Tu prends conscience de la réalité des choses, de ce que représente la guerre. Mon père m’a emmené à Oran par exemple, à l’endroit où est mort Cheb Hasni. Ils jouaient tous les deux dans le même club de foot à Oran, à l’ASMO. Ils se connaissaient bien, Hasni jouaient avant-centre et numéro 10. C’est des histoires de fou.
Ça t’arrive de tisser un lien entre la musique et l’histoire d’un peuple, d’un pays ?
Prend la musique albanaise par exemple, j’adore. Et c’est un peuple qui a un passé extrêmement douloureux.
Ça ressemble à quoi la musique albanaise ?
Ça ressemble à un peu à la musique turque. Il y a aussi ce rappeur albanais, qui vit à Harlem. Il y a une histoire de fou entre lui et 50 Cent. 50 devait faire un concert en Albanie et le mec devait faire la première partie. Les Albanais ont un égo de fou, donc le mec a refusé. Du coup, 50 Cent fait son concert et deux semaines plus tard, l’autre remplit le même stade et commence son concert en insultant 50 Cent. Ce gars, c’est le 2Pac albanais.
(Di-Meh lance « UFF » de Veysel et chantonne)
Regarde, c’est n’importe quoi, le barbecue géant et la bête empalée sur la broche ! Je les ai déjà vu en vrai, c’est des monstres. En Allemagne, t’as aussi un gars qui s’appelle Xatar, c’est le roi du rap game là-bas. C’est une montagne. Lui, il arrive une fois à un festival en Allemagne, tu avais tous les cains-ri : Travis Scott, Cardi B… Ils étaient terrorisés ! Ils ont vu une clique de Turcs balèzes arriver, ils ont rien compris (rires).
Pour revenir sur le projet, Mektoub c’était aussi le nom du restaurant de ton père. Tu en gardes quels souvenirs de ce lieu ?
Il y avait des showcases, ça défilait. Plus qu’un simple restaurant, c’était un vrai lieu de vie. J’en garde des souvenirs de fou. J’ai appelé mon album pour commémorer ça. Quand mon père est arrivé en Suisse, il s’est direct lancé dans ce projet. Le Mektoub c’est l’amour de mes parents, la musique que j’écoutais en étant petit…
Tu te verrais un jour reprendre le business familial ou créer une sorte de lieu de vie du même type ?
Fort, fort, fort. J’ai longtemps travaillé dans un skateshop, c’était la maison de quartier. Les gens passaient, fumaient des joints… J’aime ce concept d’avoir un spot où tu peux accueillir tes proches.

Le fait d’être vendeur dans un skateshop plus jeune a développé ton goût pour la mode ?
Je ne suis pas un gros consommateur, je ne suis pas du genre à péter tous les nouveaux produits. Je suis exigeant, j’aime les belles pièces. Je travaille avec quelques créateurs suisses. À Genève, tu as une école de mode qui s’appelle la HEAD. J’ai capté des élèves de là-bas pour faire des brainstormings et créer des pièces ensemble par exemple. C’est un truc qui me parle.
La Suisse n’a pas trop les yeux rivés sur la culture. On a tous cette volonté de réveiller la scène culturelle. C’est notre combat.
Di-Meh
Tu vas davantage fonctionner au coup de coeur que sur la hype d’un produit ?
La hype, je m’en fous. C’est vrai que tu as des sorties qui sont incroyables, mais si je vois que c’est injouable pour moi, je ne vais pas faire une crise (rires). Je suis plus un gars des marchés aux puces, des fripes. Depuis que j’ai travaillé dans un shop, je kiffe l’aspect humain dans la transaction. Je kiffe le fait de trouver une sape qui te surprend.
Ton passé au sein de la communauté skate a influencé ton style ?
Fort. Vu que je bossais dans un shop, je voyais que le skate avait toujours deux ans d’avance sur les tendances. Quand on commençait à vendre des bobs, la tendance des bobs est arrivé un an et demi après. Pareil pour les 5-Panel, dix-huit mois plus tard. C’est une communauté précurseure sur la mode. C’est plein de mondes qui s’entrechoquent, tu vas y retrouver tous les styles que ce soit en musique ou en mode. Quand tu vois ça en étant petit, ça t’ouvre l’esprit de fou. Tu sais que tu ne vas pas te cantonner à une seule chose.

Quand tu étais plus jeune, tu as aussi pas mal bourlingué du côté de Paris au début des années 2010. C’était quoi ton état d’esprit à cette époque ?
Je prenais beaucoup le train, je fraudais beaucoup le train surtout ! J’allais chez ma tante, j’étais en apprentissage, je devais avoir 15-16 ans. Dès que mon taff s’est fini, je suis parti habiter à la 75ème Session pendant un an. Une année de charbon intense, sans revenus (rires). J’allais manger chez ma tante, je revenais, je charbonnais.
La 75ème Session c’était une école. On a marqué une époque. C’est un endroit légendaire où tout le monde se distinguait. C’était un laboratoire où gravitaient des gars venus de tous les horizons.
Di-Meh
Ça symbolisait quoi Paris pour toi ?
C’était l’endroit où il fallait avoir faim. Je l’ai toujours maintenant cette dalle, c’est juste qu’elle se concrétise d’une autre manière, plus intelligente. Avant, ça partait dans tous les sens.
Il y avait un vrai bouillonnement à l’époque, avec plusieurs acteurs importants, comme la 75ème Session ou l’Entourage. Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
Quand j’étais à la 75ème session, j’ai rencontré Népal. Je l’écoutais déjà, mais bien sûr, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Je suis arrivé et j’ai dit : “Ouais ça rappe ici ou bien ?“. Mon gars Népal, il n’avait pas trop la gueule de l’emploi et il me dit qu’il rappe. À l’ancienne, je démarrais tout le monde (rires). Et là, il se met à rapper et je capte que c’est lui ! Je reconnais direct le flow, les textes (rires). On a connecté, il m’a fait mon projet Reste calme (2014), une grosse aventure.
Ce genre d’effervescence, c’est quelque chose d’encore possible selon toi ?
Comme dit Limsa d’Aulnay, la 75ème Session c’était vraiment une école. On a marqué une époque. C’est un endroit légendaire où tout le monde se distinguait. C’était un laboratoire où gravitaient des gars venus de tous les horizons.

Vous en parlez encore maintenant, quand vous vous croisez ?
Il y a de la nostalgie, bien sûr. Avec un Limsa, on se raconte souvent les histoires de l’époque. Par exemple, j’ai perdu un chien une fois à Saint-Denis.
Tu l’as retrouvé depuis ?
Oui, oui j’ai retrouvé le chien (rires). Gros, j’avais carrément perdu le chien de la 75ème Session. L’autre fois, Limsa disait : “T’es le seul humain que j’ai rencontré dans ma vie qui a perdu un chien.”
Et en tant que grand nom du rap suisse, comment tu as vécu le fait d’arriver sur un marché français qui est ultra-saturé ?
J’adore. Ça me stimule, c’est un challenge. Ça fait longtemps que j’arpente la France, je n’ai toujours pas fini de la conquérir.
Tu en es où dans cette conquête justement ?
Ça se passe bien pour l’instant. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, mais on a déjà accompli des grandes choses. La Suisse c’est un petit pays, mais avec énormément de rappeurs. Rien qu’à Genève, il y a beaucoup d’artistes. J’ai des anciens qui ont rappé, qui ont fait des choses. J’ai un grandqui s’appelle Mam, il a produit pour G-Unit, il a fait des bails à New York. On est un pays de grands producteurs. Même aujourd’hui, on a un Turc de Zurich qui s’appelle ØZI, qui a produit sur AstroWorld et pour Drake. Le beatmaking est ancré dans notre culture, on a pris ça des Allemands.
C’est possible de bien gagner sa vie en tant qu’artiste en se cantonnant juste à la Suisse ?
Tu peux, un gars comme Stress a réussi à faire carrière seulement en Suisse. Mais tu vas être limité. Là où ça va être difficile, c’est pour les Suisses-allemands. Déjà, ils rappent en suisse-allemand et sont confrontés à la barrière de la langue. Et le problème, c’est que les Allemands, ils ne valident pas le suisse-allemand. Même eux, ils sont fermés. Les Suisses-italiens peuvent faire leurs bails en Italie comme nous en France.

Tu te placerais où sur la carte du rap francophone ?
Le statut a changé, mais j’ai envie de te dire qu’il doit changer encore plus. On est en train de monter les fondations, un pont entre la Suisse et la France.
Qu’est-ce que tu vois comme grosse étapes à venir pour franchir un cap ?
Franchement ? Un disque d’or ce serait cool. La Suisse est un vivier de talents, on a des Clint Capela, des Kevin Mbabu, on a des gars qui sortent de chez nous. Et on a tous cette volonté de réveiller la scène culturelle du pays. C’est notre combat.
Ça fait longtemps que j’arpente la France, je n’ai toujours pas fini de la conquérir.
Di-Meh
Un Clint Capella, il importe ça aux États-Unis ?
Oui carrément ! On a déjà vu des stories de vestiaires avec des sons de Makala, il est là et il soutient. Mbabu c’est pareil, un club comme le Servette Genève aussi. Mais les Suisses n’ont pas l’œil rivé sur la culture.
Comment tu expliques ça ?
Regarde sur le plan politique, ce sont des gens qui adorent rester neutres, dans l’ombre, ne pas faire de vagues. Les francophones de Suisse sont influencés par la France, ils ont les mêmes références. On connaît plus la politique française que la politique suisse pour te dire. Il y a même des gens qui connaissent mieux La Marseillaise que notre hymne suisse ! La télé-réalité et le rap français ont influencé beaucoup les petits de chez nous. Il y a un manque d’identité, en quelque sorte.
Ça regarde Les Marseillais en Suisse ?
Laisse tomber, c’est trop… Tu as même des meufs d’Annemasse dans le 74, qui disent qu’elles viennent de Genève quand elles font de la télé-réalité ! Elles ne sont pas de Genève du tout, non, elles viennent d’Annemasse, dans le 74. Genre Astrid, elle ne vient pas de Suisse frérot. Elle vient d’Annemasse ! Nabilla c’est pareil. Nabilla ne vient pas du tout de Suisse, c’est une meuf de Rhône-Alpes !
Donc des gens se font passer pour suisse, alors qu’absolument pas ?
Mais oui. Même moi je ne suis pas suisse ! J’ai un permis de séjour, je n’ai pas la nationalité. Je suis né en Suisse, mais on n’a pas le droit du sol, donc je dois renouveler mon titre de séjour tous les 5 ans. Pour avoir la nationalité, c’est une guerre, ils sont en mode Trump. Pour nos anciens, ça peut être compliqué toutes ces galères administratives. Alors qu’ils sont pourtant là depuis longtemps.
CRÉDITS
Photos : Tony Raveloarison (@tony.r3)
Stylisme : Selim Moundy (@selimmoundy)
Interview : Julien Perocheau (@julienperocheau)