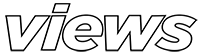Le rap est physique

Profondément ancrée dans son époque et ses modes de consommation, capable de se moduler pour résister à l’épreuve du temps, la culture hip-hop est, depuis ses origines, attachée à la notion de matériel et d’expérience physique. Tout est autant une affaire de mentalité que de style. Les objets, qu’ils soient vestimentaires ou musicaux, ont toujours été présents, même quand les éléments semblaient s’acharner sur eux. Le monde de la mode a vite compris que les artistes hip-hop représentaient une manne économique conséquente, et quand les ventes de disques ont chuté, au début des années 2000, les mixtapes et bootlegs ont pris le relai. Et tout s’est prolongé. Parce que tout ça est une affaire de débrouille, pas vrai ?
Après avoir conquis les plateformes de streaming, le rap s’attaque maintenant à un nouveau chantier : remettre le physique au goût du jour, dans une industrie où le numérique règne en maître du jeu.
De la tête et des épaules
Les traditionnels Spotify Wrapped de l’année viennent de dévoiler leurs classements et le constat est sans appel. En France, le rap est partout et domine largement les dix premières places des artistes et titres les plus écoutés du pays. À tel point qu’il faut fouiller pour trouver l’exception, à la dixième place du top Spotify, et à la quatrième de celui d’Apple Music – en dehors de Tayc – : seules Dua Lipa et Angèle, avec leur collaboration « Fever » se taillent une place parmi leurs homologues MCs. En point d’orgue : le rap sudiste, avec Naps, SCH, Soso Maness, Alonzo et JuL en tête d’affiche.
Le rap domine le streaming, mais si l’on se penche sur les ventes d’albums physiques, le constat est différent. Début 2021, le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), dévoilait dans un rapport le classement des vinyles les plus vendus de l’année 2020, format qui représentait une vente physique sur trois. Le premier rappeur, Lomepal avec Jeanine, ne se situe qu’à la quatorzième position, devant IAM et Nepal, en vingt-huitième place. Et si en 2020, le rap dominait aussi les statistiques de streaming, le top global des albums les plus vendus de l’année était plus homogène, avec seulement trois artistes de rap dans les dix premières places du classement.
Ce retard, tout relatif, par rapport aux albums de variété française pourra-t-il être inversé ? Le rap français n’est pas étranger aux sommets des classements des ventes d’albums. Diam’s, IAM, MC Solaar, pour n’en citer que quelques-uns, ont déjà, en leur temps, montré qu’ils pouvaient exister sur le même plan commercial que leurs homologues. Reste qu’aujourd’hui, le canal des ventes physiques, plus ancré dans les habitudes d’achats de consommateurs d’autres genres musicaux, contrebalance la domination digitale des artistes de rap.

En 2021, et même s’il faut encore attendre quelques semaines avant que le SNEP ne dévoile ses chiffres, la tendance devrait se confirmer. Avec un fait notable : en fin d’année, en France, nombre de rappeurs ont multiplié les appels du pied vers le format physique.
Tarik Chakor, Maître de conférences à Aix-Marseille Université et co-fondateur de La Firme, agence qui créé des partenariats entre artistes et marques, explique : « C’est une manière de se différencier des autres, au sein d’une offre immense. Il faut occuper l’espace médiatique et faire parler de soi. Il y a différents leviers pour ça. L’hyperproduction de contenus : ce que fait un JuL, un enfant du streaming. Il produit énormément, car ça colle aux méthodes de consommation actuelles, au streaming et à son fonctionnement. Son public ou celui de Naps n’attend pas forcément du physique […] On peut aussi créer une relation authentique, qui va au-delà de la musique, et qui donne le sentiment d’un lien privilégié avec l’artiste. Dans cette profusion d’offres, il est indispensable de ne pas juste sortir un album mais de créer aussi du contenu en parallèle. Cette réflexion autour du physique est un des moyens ».
PNL, jamais les derniers lorsqu’il s’agit de monter des opérations de communication à grande échelle, l’a bien compris : parmi les plus grosses ventes de l’année 2019, tous genres et pays confondus, l’album Deux Frères écoule plus de 50% de ses ventes en CD. Le succès s’explique en partie par le format. Deux versions du même album sont disponibles, avec deux pochettes différentes et un titre bonus dans chacune d’entre elles. Un ouragan médiatique avant qu’Ademo et NOS ne disparaissent de nouveau, conscients de laisser quantité d’auditeurs dans l’attente, conscients aussi de leur fidélité, et certains qu’ils se rueront sur leur prochaine sortie.

Plus présents médiatiquement que le duo des Tarterêts, Orelsan, Koba LaD, Lacrim et Ninho ont tous développé, à quelques semaines d’intervalle, une expérience dépassant le simple cadre musical.
Toujours plus proches
Alors que Koba fait gagner un tour en char d’assaut avec une précommande de Cartel : volume 2, Lacrim glisse des billets de 500 euros dans des boitiers d’une réédition de son premier album, pendant que Ninho organise une chasse au trésor en région parisienne pour gagner une place à un de ses concerts et qu’Orelsan, deux semaines avant la sortie de Civilisation, met en vente quinze versions différentes de son album. Plus radicale, pour son grand retour après plusieurs années d’absence, la Sexion d’Assaut annonce sur son compte Twitter que son nouvel album sera uniquement vendu lors de ses concerts à partir de mai 2022, faisant le pari de se passer du streaming.
Guizmo, lui, dévoile un coffret comprenant une bande-dessinée de cinquante-deux pages retraçant son parcours et un exemplaire de son album 10 ans. Plus tôt dans l’année, le rappeur Georgio s’était associé aux journalistes Raphaël Da Cruz et Neefa pour participer à l’écriture d’un livre sur sa carrière, vendu dans un pack avec son album Sacré. Une manière de faire le bilan en regardant dans le rétroviseur, tout en rendant ses lettres de noblesse aux contenus pérennes, qui trônent sur des étagères et résistent à l’épreuve du numérique. Même si les habitudes de consommation ont changé, et que les lecteurs de CDs se font rares, le besoin de collectionner et de « posséder » une œuvre semble rester intact auprès d’une population jeune, pour qui le digital est une évidence.

De l’autre côté du globe, dans les rues de Buffalo, une ville voisine de New York, les rappeurs du collectif Griselda se sont eux aussi imposés comme les fers de lance de ce rap indépendant, en circuit court, où le format physique est le socle sur lequel tout se bâtit. D’abord lancé comme une marque de vêtements, Griselda multiple les albums et les mixtapes, commercialisés via leurs propres structures et en quantités limitées. En s’associant au label Daupe!, ils sortent plusieurs éditions du même projet, en CD et en vinyle, et communiquent sur le fait qu’il n’y aura qu’un seul et unique pressage. La totalité se vend presque immédiatement. A chaque sortie.
Hyperactifs et malins dans leur communication, ils tablent sur la rareté de leurs produits et sur une fanbase fidèle et acquise à leur cause, prête à dépenser un petit pécule pour acheter des objets estampillés Griselda. D’abord en retrait des schémas traditionnels de l’industrie du disque, proposant une musique calibrée pour un marché de niche, le fait que ces artistes aient réussi à devenir à ce point incontournables dans le paysage rap mondial, alors même que leurs noms n’apparaissent presque jamais dans les hauteurs des classements des artistes les plus streamés, est hautement symbolique et rappelle de l’importance du circuit physique.
Tarik Chakor abonde : « C’est une réponse logique aux évolutions du marché et des modes de consommation. […] Parallèlement, il y a une culture du physique et même du CD. On voit des personnes qui exposent leur collection et en sont fières. […] On est dans une ère de « fétichisation » du disque. Il devient un objet de collection. Les rappeurs, labels et maisons de disque l’ont compris, et certains jouent sur cet axe-là. Ils se disent « on sait que les personnes qui vont acheter ces CDs sont généralement les plus engagées, les plus « fans », et de potentiels collectionneurs ». Il y a aussi un côté important : celui d’afficher son soutien. Tu peux montrer que tu as acheté un CD physique, mais montrer que tu l’as streamé est plus compliqué ».
Indépendant jusqu’à l’os
Le retour au format physique est aussi – et surtout ? – un symbole et une affaire de mentalité. Quand Dinos, avant la sortie de Stamina, se filme en train d’appeler des fans qui ont précommandé son album, puis se déplace jusqu’à chez eux pour les remercier, il se rapproche de son public et envoie un message fort quant à sa direction artistique : leur relation sera aussi privilégiée qu’elle peut l’être. Ses disques ? Les acheter revient à soutenir sa démarche. Près des oreilles et du cœur, en somme. La stratégie fonctionne.
Quand des vinyles de Stamina, sont mis en vente pour la première fois, le stock s’écoule en quelques minutes. Même chose lorsque Booba presse vingt-et-un vinyles, retraçant sa carrière de 2002 à 2017, dans un coffret vendu 199€ : les fans saisissent l’opportunité et prouvent qu’il existe une audience assez mature et fidèle pour investir une telle somme d’argent dans des objets.
« Si on revient en 2019, pour Les Etoiles Vagabondes, quand Nekfeu sort une extension, avec un effort sur le packaging, ça colle à son image, à ce qu’il est », affirme Tarik Chakor. « Laylow a vendu des dizaines de milliers d’exemplaires physiques, alors que ce n’est plus la norme actuellement. Il y avait un univers, et une communauté très engagée prête à le soutenir. Ce n’est pas étonnant qu’il ait rempli aussi vite son Bercy ».

L’ « objet » serait-il de retour ? Difficile de qualifier ces stratégies de novatrices, même si les relais médiatiques massifs dont elles ont bénéficié les feraient presque passer pour une petite révolution. Revenant à une forme d’artisanat, elles évoquent autant une philosophie d’indépendance, dans laquelle les artistes maîtrisent tout et ont donc une liberté créative totale, qu’une machination marketing vouée à générer des ventes. L’histoire se souvient : vingt ans en arrière, le rap français avait déjà démontré sa capacité à créer des liens pour lutter contre des forces qui le poussaient vers le bas.
Dans les années deux mille, des labels comme 45 Scientific, terre des premiers exploits de Booba et d’Ali, avaient eux aussi fait le choix de l’indépendance et du « physique ». Profitant de l’engouement du marché des mixtapes, ils avaient externalisé uniquement l’aspect distribution de leurs albums en misant sur leur capacité à atteindre leur marché-cible sans appui logistique d’envergure. Nul besoin de préciser que les efforts ont été payants.
Pied de nez au déclin des ventes de l’industrie du disque, et à un désengagement des labels nationaux dans le rap français, les streets-CDs et mixtapes se vendent alors dans la rue et dans des boutiques spécialisées, au sein d’un marché parallèle dans lequel des collectifs comme Time Bomb, le Secteur Ä et Beat 2 Boul dictent la tendance.
A Boulogne-Billancourt, LIM, fer de lance du rap indépendant, écoulait des milliers d’exemplaires de ses albums via sa structure Tous Illicites – réussissant l’exploit de faire de Délinquants (2007) un disque d’or en seulement quelques mois –, pendant qu’Alpha 5.20 et son Ghetto Fabolous Gang s’installaient dans le marché aux puces de Clignancourt et vendaient leurs sorties, vêtements et autres merchandising. « On vit du rap et on en vit bien. Il n’y a plus d’argent sale là-dedans. On récupère du cash et on réinvestit, ça se multiplie. », affirmait Alpha 5.20 au journaliste Thomas Blondeau, au cours d’une interview dans Le Monde Diplomatique.
Le rap a toujours trouvé le moyen d’atteindre ses objectifs, et si on lui fermait les portes, il les défonçait à grands coups d’Air Max.
Une histoire de marathon
Outre-Atlantique, un autre rappeur, que Dinos cite d’ailleurs dans le titre « Juste Un Clou, », avait adopté un positionnement similaire à celui de l’auteur de Stamina,, aussi proche de son public que possible. Cette fois en direct des rues de Crenshaw.
Toute la carrière de feu Nipsey Hussle s’était construite sur la notion de proximité avec ses auditeurs. Les labels ne veulent pas le signer ? Il prend la tangente et assure lui-même la distribution de ses albums. Il sillonne Los Angeles et ses environs en distribuant des copies de ses Mixtapes, organise des événements chez lui, dans son quartier, pour diffuser sa musique. « All Money In, No Money Out / Tout l’argent entre, aucun ne ressort » : le slogan de sa structure résume sa mentalité. Il s’agit pour lui de « fuck the middleman », soit de « supprimer les intermédiaires », pour exercer un contrôle optimal sur ses œuvres et leur commercialisation tout en maximisant les profits.
Et tout commence chez lui, son monde où gravitent les personnes qui adhèrent au mouvement. La stratégie fonctionne : en 2013, il sort Crenshaw et lance le mouvement #Proud2Pay – « fier de payer » –, avec une édition limitée à 1000 exemplaires de cette Mixtape, pour 100 dollars pièce. La totalité du volume est vendu en moins de vingt-quatre heures. Le label de Jay-Z, Roc Nation, achète 100 copies à lui tout seul, attisant l’intérêt médiatique autour de cette initiative que certains jugeaient présomptueuse. « Observez à quel point mon mouvement est suivi, regardez comme mes fans adhèrent à ma musique, à mes textes, à ma personnalité. Et quand je leur demanderai de l’aide, ils seront présents, parce qu’il ne s’est jamais agi que de musique avec moi », semblait-il dire.
La relation de Nipsey avec ses fans a été la clé de sa réussite : en vendant des mixtapes, des t-shirts, des hoodies et des accessoires de main à main, dans des pop-up stores ou dans le magasin qu’il ouvre avec son frère, au cœur de Crenshaw, il occupe le terrain et multiplie les sources de profits. Il attendra longtemps avant de quitter le circuit indépendant en signant sur un label national. Ce sera l’aboutissement de son « marathon », la philosophie qui lui colle à la peau, et une manière de laisser derrière lui ce qui a fait sa réputation et a inspiré tant de ses homologues. Assassiné devant son propre magasin de vêtements, à côté d’une structure qu’il avait créée pour développer l’accès à l’emploi et aux technologies pour les jeunes de Los Angeles, faisant des ponts entre le Sud de sa ville et la Sillicon Valley, Nipsey était devenu l’archétype du « hustler ». Un débrouillard pour qui le canal physique avait fait des miracles et créé, dans son sillage, des centaines d’emplois.
En France, le positionnement de Nipsey a fait des remous. On citera par exemple le label indépendant Foufoune Palace, terre d’accueil de Luidgi, Tuerie, Sage Pee ou Ryan Koffi qui, lui aussi, table sur un lien étroit entre le merchandising et la musique. Mo’, manager de la structure, expliquait pendant une interview avec Camino TV à quel point la carrière et la mentalité de Nipsey Hussle le guidait dans ses prises de décision.
Après la crise de l’industrie du disque, la démocratisation du piratage, les bootlegs, l’avènement du streaming, le retour en grâce du format vinyle et la crise sanitaire, le rap se tourne vers l’avenir. Rouleau compresseur tout-puissant et omniprésent, le rap français a les armes pour partir à l’assaut du marché physique. Et le dominer, comme il le fait déjà avec le streaming. Il y a déjà le public, les médias, les relais, les labels et un marché prêt à consommer. Les ingrédients du succès sont dans son ADN : l’esprit de compétition et la capacité à affronter les coups durs, hérités de ses origines.
Et, surtout, cette propension, qui lui colle à la peau, à créer des tendances.
Nicolas Rogès
Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter