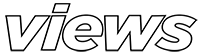Lorsqu’on pense “rois sans couronnes” ce sont Salif, Nessbeal ou Despo Rutti qui viennent en tête. Des précurseurs cachés dans l’ombre, ceux qui ont inspiré les artistes qu’on adule aujourd’hui, ceux également dont on se rend compte trop tard qu’ils méritaient, eux aussi, d’être couronnés. Si ce sont les rappeurs qui sont identifiés comme tel, le plus grand roi sans couronne de la musique actuelle, en France et même dans le monde, est peut-être un genre musical : le zouk.
“Contvct” de Rsko et Aya Nakamura, “Villa” de Shay, “VVV” de Booba ou encore “Joli Bébé” de Naza… Si vous écoutez du rap ou ce qu’on appelle aujourd’hui de la “pop urbaine”, vous écoutez déjà beaucoup de zouk. Caché derrière d’autres appellations, le zouk est connu de tous mais n’est reconnu de personne. Hors des studios, il se réduit à un chuchotement. Difficile alors de reprocher au grand public d’être incapable de l’identifier, tant il est peu défendu et mis en avant, que ce soit par les artistes qui le font ou dans les médias où il se transforme en “rythmique ensoleillée” et en “sonorité exotique”. Des descriptions qui ne rendent pas hommage à cette musique profonde et identitaire née en Martinique et en Guadeloupe. Retour sur ce genre musical à part entière qui cherche encore désespérément sa couronne.
Cet article s’accompagne d’une playlist disponible sur Apple Music et Spotify.
Les tambours à l’origine du zouk
Si cette musique a pris ses racines aux Antilles françaises, derrière les nouveaux hits de zouk qu’on écoute aujourd’hui, on retrouve surtout des artistes issus de la diaspora africaine. Aya Nakamura est d’origine malienne, Ronisia vient du Cap-Vert quand Niska et Naza, auteurs du morceau zouk “Joli Bébé”, sont d’origine congolaise.
Mais l’influence du zouk ne s’observe pas seulement chez nous en France : “Moi j’en entends partout du zouk, parfois sous d’autres noms comme la Kizomba ou l’Afrobeat par exemple, mais ce sont les mêmes rythmiques”, livre Orlane, chanteuse de zouk à succès révélée dans les années 2000. Un constat appuyé par Gérald Désert, sociologue, enseignant-chercheur à l’université des Antilles et auteur du livre Le Zouk – Genèse et représentations sociales d’une musique populaire : “Si vous prenez le reggaeton par exemple -qui s’inspire de multiples sons bien sûr- on y retrouve beaucoup le zouk dans ses percussions qui sont celles du Bèlè martiniquais et du Gwo-ka guadeloupéen”, assure le chercheur. “La base du zouk c’est ça, il prend naissance dans les tambours. C’est cette rythmique qu’on entend dans d’autres musiques, dans d’autres pays aujourd’hui.” Ces musiques traditionnelles que sont le Bèlè et le Gwo-ka et qui transportent l’héritage des esclaves venus d’Afrique noire, des artistes antillais les ont reprises pour créer le zouk et l’exporter partout dans le monde : le groupe Kassav.
Si le mot “zouk” précédait le groupe et désignait des fêtes dans les années 1970 – les Antillais utilisaient l’expression “aller en zouk” pour qualifier le fait de sortir danser – Kassav va transformer cette expression en son. Formé par Freddy Marshall et Pierre-Edouard Decimus en 1979 le groupe sera rejoint par la suite par certains noms qui écriront sa légende comme Jocelyne Beroard, Jacob Desvarieux ou Patrick Saint-Eloi. Ensemble, ces chanteurs et ces musiciens ajoutent aux bases de Bèlè et du Gwo-ka des influences de biguine (musique traditionnelle née en Martinique), celles d’autres sons venus des Caraïbes (dancehall, merengue, reggae….) et enfin le groove des musiques du moment aux Etats-Unis (funk, jazz et même rock) pour créer un son sans équivoque.

Véritable cri du cœur culturel antillais chanté en créole, à la fois représentatif de l’histoire de Martinique et de Guadeloupe mais aussi de l’esprit de fête que le mot zouk incarne depuis son origine, cette musique devient virale aux Antilles. Ce n’est d’ailleurs pas Kassav qui a choisi de nommer sa musique “zouk” mais bien le public, preuve de la notoriété du groupe dans les “zouks” en Guadeloupe et en Martinique. Et le succès va rapidement dépasser les Caraïbes pour s’étendre partout.
L’Afrique, terre de zouk
Entre 1985 et 1995 Kassav amasse cinq disques d’or et un disque de platine (une performance rare à l’époque) et remplit des stades aux quatre coins du monde. Mais c’est surtout dans les communautés noires que le groupe rencontre le plus d’écho, notamment en Afrique.
En 1985, il se rend en Côte d’Ivoire à Abidjan pour son premier concert sur le continent africain. 40 000 personnes assisteront au show. Kinshasa, Yaoundé ou encore Luanda en Angola…. Au cours de cette tournée africaine, Kassav draine des foules. Preuve que sa musique si elle est antillaise est aussi une musique noire, preuve aussi du lien qui unit Martinique et Guadeloupe à l’Afrique. Le succès bluffe le groupe lui-même qui adaptera par la suite ses compositions à son public africain et retournera régulièrement sur le continent pour des concerts. Un clip sera même tourné à Kinshasa, celui de “Sye Bwa”.
À travers ses concerts mais aussi via les cassettes pirates et les radios, le zouk de Kassav s’est ainsi solidement installé sur le continent africain. Et on retrouve ce même amour pour le zouk chez les jeunes générations aujourd’hui. “C’est aussi notre musique”, affirme Hardlevel, beatmaker et ingénieur du son d’origine camerounaise et ivoirienne qui a travaillé sur tous les morceaux de “DNK”, le dernier album d’Aya Nakamura. “C’est une musique que j’aime, que j’apprécie et que j’écoute depuis tout petit, au même titre que nos musiques traditionnelles”.
Même ressenti chez les beatmakers Cap-Verdiens Max et Seny, qui ont composé énormément de hits zouk qu’on attribue à la pop urbaine et qui travaillent avec des artistes établis du genre comme Wejdene, Ronisia ou Aya Nakamura : “Avec Papa on a eu notre dose ! Kassav, Patrick Saint-Eloi…. (rires). En fait il écoutait vraiment tout le zouk qui sortait.” Comme les Martiniquais ou Guadeloupéens, les jeunes Camerounais, Ivoiriens, Cap-Verdiens et les autres enfants d’Afrique noire écoutent du zouk depuis tout jeune : “Ce sont des artistes qui ont grandi avec le zouk ! Qu’ils soient compositeurs ou interprètes, lorsqu’ils arrivent dans un studio, cette musique leur parle tout de suite. Moi-même étant d’origine africaine, je peux vous affirmer que mes parents écoutaient eux aussi énormément de zouk”, explique Buata Malela, sociologue spécialiste de la pop urbaine ayant travaillé sur la réappropriation du zouk par ce genre musical.
Le snobisme de la France coloniale
Comme chez eux aux Antilles, en Afrique ou ailleurs à l’étranger, Kassav cartonne en France hexagonale avec des chiffres qui parlent d’eux-même, notamment en termes de concerts. En plus de 40 ans de carrière, le groupe a ainsi rempli le Zénith de Paris 63 fois (un record), c’est aussi le tout premier groupe à avoir rempli le stade de France. Même en solo, les albums des membres de Kassav cartonnent et contribuent encore davantage au succès du groupe. Pourtant, “les membres de Kassav’ disaient être vus comme un groupe français à l’étranger, mais antillais en France hexagonale” , racontait Claudy Siar, journaliste présentateur de Couleurs Tropicales sur RFI, fondateur de Tropiques Fm et ancien producteur de zouk, pour le journal Libération en 2021.
Les institutions culturelles en France ne vont jamais considérer Kassav comme des artistes français, si bien qu’en allant à la Fnac aujourd’hui vous pouvez encore trouver leur album dans la catégorie “musique du monde” dans certains magasins quand celui d’Aya Nakamura entrera dans “hip-hop”. Difficile en revanche de trouver une catégorie “zouk”. “Il y a un vrai déni de l’apport de Kassav et du zouk à la culture française parce que le zouk qu’ils ont créé, une musique des tambours chantée en créole, ne correspond pas aux standards fixés par les producteurs et les institutions culturelles de France”, détaille Gérald Désert.
Le constat va se répéter avec des générations de chanteurs et chanteuses de zouk antillais talentueux qui perpétueront la culture créée par Kassav. De Tanya Saint Val à Fanny J en passant par Jean Michel Rotin, jamais un artiste zouk antillais n’est arrivé à se hisser parmi les têtes d’affiche en France. “Pour passer en radio, dans les médias, pour être diffusé, il faut correspondre aux désidératas des maisons de disque, il faut que votre musique soit séduisante, exotique”, explique Gérald Désert. Pour être diffusés, les artistes antillais vont ainsi être contraints de chanter en français et de délivrer une musique légère où le militantisme prôné par Kassav va disparaître au profit d’un zouk édulcoré, laissant place uniquement au zouk love, centré sur l’amour.
Réduite au fantasme exotique français et considérée comme une petite musique, estivale et étrangère, le zouk passe au second plan alors même qu’il fonctionne très bien. Si elle ne s’est pas installée durablement en France hexagonale, cette musique a en revanche offert des hits mémorables. Hormis l’hégémonie Kassav, on peut notamment citer en exemple “Ancré à ton port” le morceau de Fanny J, “Emmène-Moi avec Toi”, de Perle Lama, ou encore “On a changé” du trio Guadeloupéen Les Déesses. “Ce qui nous a manqué à l’époque, ce sont les médias. Je pense qu’on était populaires, qu’on était même écoutés mais pas assez mis en valeur. On faisait un zouk trop caribéen pour eux”, résume Kim chanteuse de zouk dont le premier album “Premiers pas” sorti en 2009 a été certifié disque d’or, avec des hits comme “Confidence” ou “Mon ami”. Conséquence du snobisme du milieu culturel français, le zouk n’a survécu en France qu’à travers ceux qui l’ont connu et qui l’ont transmis à leur enfants, mais n’a jamais été mis en avant.
Les chanteurs de zouk ne sont pas les seuls artistes antillais à subir ce système à double vitesse dans lequel il est d’abord nécessaire de se faire connaître en Martinique ou en Guadeloupe avant d’arriver en France, où il devient souvent vital d’obtenir un feat avec un artiste installé et de modifier sa musique pour se faire remarquer. Dernier exemple retentissant de cet état de fait aux relents coloniaux : l’arrivée tardive du streaming en Martinique et en Guadeloupe en 2021 près de 10 ans après l’Hexagone, sous la pression des artistes antillais eux-mêmes dont Kalash notamment. Dans une industrie où le streaming est devenu indispensable pour compter les ventes, se mettre en valeur, entrer en radio ou en festival, ne pas connaître ses chiffres de streams est un handicap supplémentaire pour des chanteurs/rappeurs antillais dont les musiques caribéennes (zouk, dancehall… etc) sont souvent reprises par d’autres artistes à succès en métropole. En plus du streaming désormais actif aux Antilles, on note aussi que l’accès à Internet permet aux artistes martiniquais et guadeloupéens d’obtenir plus de visibilité malgré des institutions musicales qui les relaient au second plan.
Le zouk chez lui, un mendiant assis sur un rocher d’or
Si le zouk a été marketé comme la musique du tube de l’été en France hexagonale, les Guadeloupéens et les Martiniquais ont aussi leur part de responsabilité dans le manque de reconnaissance qu’il subit aujourd’hui. Alors qu’il est repris partout dans le monde, “aux Antilles, le débat autour du zouk c’est de savoir s’il est mort”, se désole la chanteuse Orlane. “On n’a pas défendu l’art et la culture du zouk, ou alors ça a été chacun dans son coin, mais jamais de façon collective. On n’a pas su faire du zouk une cause nationale. Il a n’a jamais eu de lettres de noblesse.” Un avis partagé par Gérald Désert : “Chez nous en Martinique, il n’y a pas d’auto reconnaissance de notre culture, vous avez des gens qui considèrent que le zouk n’est pas une grande musique comme le jazz ou la salsa. Alors que le zouk est une musique exceptionnelle qui a été saluée par les plus grands musiciens !” Parmi eux, on peut notamment citer Manu Dibango, Wyclef Jean, membre des Fugees ou encore Miles Davis qui parlait du zouk de Kassav comme la musique du futur.
“Nous n’avons pas pris conscience de la grandeur musicale que nous avons, de ce que nous avons entre les mains. Nous avons de l’or là et on ne sait pas l’exploiter, on ne sait pas le vendre, on ne sait pas quoi faire avec.” continue Gérald Désert. Conséquence du manque de reconnaissance et d’exploitation qu’il reçoit chez lui aux Antilles et du snobisme de la France à son égard, le zouk n’a jamais été défendu, ni théorisé, ni même marketé comme le sont les autres musiques. Résultat: il est mieux vendu ailleurs. “On a tellement dénigré le zouk chez nous… Je me suis toujours dit que cette musique allait revenir aux Antilles de l’extérieur. Sauf que maintenant, plus personne n’appelle ça du zouk.” analyse Orlane. “Et comment on va reprocher aux artistes d’ailleurs de ne pas revendiquer qu’ils font du zouk, alors que nous-même ne sommes pas fier d’en faire ?”
Force est de constater qu’ici en France, on voit rarement un Franglish ou un Dadju revendiquer qu’il fait du zouk. Ce dernier a même ouvertement critiqué cette musique dans une interview en 2017, dont les propos ont ressurgi cette année donnant lieu à une polémique. On peut l’y entendre affirmer qu’il “déteste le zouk”, alors que nombre de ses morceaux s’en inspirent.
Zouk et hip-hop, des musiques soeurs
Malgré le peu de reconnaissance de la pop urbaine pour le zouk aujourd’hui, le milieu hip-hop dont elle est issue a toujours été proche de la musique de Kassav. Dans les années 2000, on assiste à la montée en puissance du zouk R’nb ou zouk’nb, un zouk plus lent, plus lascif, inspiré du R&B américain. On attribue notamment le premier morceau de ce style à “Lé ou lov” le titre sorti en 1990 par Jean-Michel Rotin, un chanteur de zouk guadeloupéen. Ce style va pleinement intégrer le zouk love au point qu’on commence à parler de ce zouk “R&Bbisé” comme d’une catégorie musicale à part entière dans les années 2000.
Plus largement zouk et R&B cohabitent à cette époque dans les foyers des diasporas noires qui voient dans le zouk une musique avec laquelle ils ont grandi. Elle compile aussi les caractéristiques d’un R&B à la peine en France : une musique d’amour, sensuelle, lascive avec des chanteurs et des chanteuses à voix. Dans les quartiers populaires, les artistes comme Kim, Slaï, Les Déesses ou Lynshaa ont ainsi inspiré toute une génération qu’on retrouve maintenant dans les studios. “Quand on a vu qu’Aya avait appelé Kim… Pour nous c’était une dinguerie parce que je pense que tout le monde attendait ce feat et c’est quelqu’un qu’elle a énormément écouté, elle l’a toujours dit”, raconte Max, le compositeur, qui a travaillé sur de nombreux morceaux présent sur DNK, l’album d’Aya Nakamura.
Côté rap aussi, les connexions existent. On peut par exemple citer le tube “Angela” des rappeurs du Saïan Supa Crew sur une production de zouk, sorti en 1997. Quelques années plus tard, on verra aussi “Laisse parler les gens” un autre tube zouk sur lequel on trouve à la fois Jacob Desvarieux, figure de Kassav et Passi icône du rap francophone des années 1990.
“Le zouk et les musiques hip-hop, ce sont des musiques soeurs. Il y a un double transfert et elles se sont enrichies l’une de l’autre.”, détaille le sociologue Buata Malela avant d’ajouter : “Plus largement en France il y a un vrai brassage musical avec de nombreuses influences diverses et c’est ce qui crée la pop urbaine, mais on n’a pas vraiment de nom pour définir cette musique, c’est quelque chose de nouveau.” La pop urbaine peut ainsi faire intervenir des influences de zouk, d’afrobeat, de reggaeton ou de raï (entre autres exemples). “Petrouchka” de Soso Maness ou “No Love” de Ninho se retrouvent ainsi dans une même catégorie, des morceaux de rappeurs qui par leurs rythmes empruntent d’autres cultures, s’inscrivent dans la pop urbaine. Ces morceaux, on les entend depuis la montée en puissance du rap et de sa culture dans le milieu des années 2010, depuis que le rap est devenue une musique populaire, l’une des plus écoutées du monde.
Une notoriété qui a valu au rap et au hip-hop le surnom de nouvelle pop, un pseudonyme logique pour Buata Malela : “Le hip-hop comme nouvelle pop, on peut affirmer cela, puisqu’il s’inspire de plusieurs genres musicaux de la même façon que la pop.” Et selon Hardlevel, le fait que les rappeurs s’orientent vers ces sonorités est plutôt logique : “Le rap est devenu comme de la pop. Avec l’autotune, les rappeurs savent maintenant qu’ils peuvent chanter et ils en ont eu marre de faire du sale, beaucoup veulent faire de la mélodie et des choses plus accessibles. Mais bon, on ne va pas faire comme Taylor Swift non plus, on ne va pas se dénaturer”, explique le compositeur. “Donc ils sont allés chercher des sonorités qu’ils connaissent bien et qui les représentent, comme le zouk par exemple. Au quartier, dans les voitures, les aprems etc, on n’a jamais arrêté d’écouter du zouk.”
Mais le rap ne reprend pas uniquement les codes de ces cultures musicales : il les lisse, les rend moins authentiques mais accessibles à un plus grand nombre pour aller chercher un public à la fois large et hétéroclite.“La pop music intègre cette dimension de l’appropriation (ou réappropriation) comme forme de son authenticité, d’une part, et tente de savoir ce que veulent les masses tout en agrégeant des publics divers et hétérogènes d’autre part, dixit Mèmeteau dans son livre consacré à la pop culture” cite Buata Malela en préambule de son étude sur l’appropriation du zouk par la pop urbaine francophone.
Un nouveau zouk presque rappé
Caractérisée par un brassage culturel fort, et difficilement qualifiable, la pop urbaine n’en reste pas moins dominée par le zouk. “La pop urbaine, c’est du zouk” n’hésite pas à affirmer le beatmaker Seny, lui qui a composé certains des plus gros succès du genre ces dernières années. Des tubes fortement influencés par le hip-hop, pour correspondre à la pop urbaine et à son public. Ainsi, si les percussions se basent sur le zouk love des années 2010, comme les morceaux de Kim ou Princess lover, ce sont les accords qui changent. “On va essayer de trouver des accords qui ne font pas zouk. On est capable de faire une rythmique zouk mais avec des accords de variété, ou des accords qui sonnent un peu plus mélancolique. En cassant ce code là, les artistes ne peuvent plus aborder la prod de la même façon que les chanteurs et les chanteuses de zouk “à l’ancienne”, explique Seny. Mais la conséquence de cette nouvelle façon de composer du zouk, ce sont bien les facilités des rappeurs pour poser dessus. Si on observe cette tendance à rapper sur des rythmiques de zouk love depuis la fin de la décennie 2010-2020, un morceau symbolise bien ce nouveau zouk pour Max. “C’est ‘Joli Bébé’, de Naza et Niska. Quand c’est sorti, j’ai mangé une claque. D’ailleurs, on s’est un peu inspiré de ça pour Contvct le titre de Rsko et Aya, et dans l’industrie, on a eu énormément de retour de la part des rappeurs. On était en studio avec Niska par exemple, et il nous a dit qu’il kiffait le morceau parce qu’il aurait pu rapper dessus.”
C’est d’ailleurs ce zouk au flow fortement inspiré du rap qui fonctionne : il allie à la fois les rythmiques zouk qui plaisent aux aficionados de ce style musical et le côté hip-hop que le public connaît et apprécie. Et même chez ceux et celles qui ne rappent pas, comme Aya Nakamura, Wejdene, Ronisia ou Franglish, les flows sont aussi inspirés du hip-hop. C’est ce que confirme Max qui, en plus de composer des morceaux est un toplineur reconnu dans l’industrie : “Ce qu’on retrouve aujourd’hui, ce sont des flows saccadés, parfois même posés à contre-temps… presque des flows de rappeurs. Pour les chanteuses de zouk qu’on écoutait jeune, ce n’était pas du tout la même chose ! Je pense qu’elles auraient pu poser sur de la variété. Il y avait de très longues harmonies et même des artistes à voix.” Certaines envolées lyriques restent ainsi en mémoire comme le fameux “Ma Destinée” de Princess Lover sur “Mon Soleil” où le “Je t’aime” iconique de Fanny J dans “Ancrée à ton port”. “Mais aujourd’hui on est plutôt dans une musique de flows. C’est ça le truc catchy. Ce n’est plus nécessaire d’avoir une grande voix pour faire un bon morceau zouk”, analyse Max. Et selon son frère Seny, l’autotune joue un rôle majeur dans ce zouk de flow :“Poser un texte avec des flows comme ceux que l’on entend aujourd’hui sur les morceaux zouk de la pop urbaine, c’est très très difficile. Ça demande un sacré niveau de concentration de tenir des notes en faisant attention au rythme sur lequel tu poses. Mais avec l’autotune, on peut ajuster les notes donc tu peux te concentrer uniquement sur ton flow.”
Plus que le débit, ce sont même les textes qui changent avec un lexique et des expressions propres au rap. Sur le morceau 200 km/H de Ronisia (un feat avec le rappeur Gazo), on peut ainsi entendre la chanteuse parler de “vice”, une expression popularisée par les rappeurs Sevranais, notamment 13 Block, qui désigne une personne hypocrite. Mais le meilleur exemple de ce phénomène, c’est peut-être Aya Nakamura dont le zouk fonctionne à chaque sortie, en France comme ailleurs. “Igo”, “Là je te parle, c’est les vrais bails”, “J’ai compris c’était quoi ton délire” ou encore “Nous deux, c’était dar”… La chanteuse utilise tout un panel d’expressions qu’on entend tous les jours dans les morceaux rap. “Elle écrit comme elle parle au quartier et comme dans la vraie vie, elle est hyper authentique. C’est vrai que ça peut faire très rap” explique Hardlevel. Même avis chez Max ; “Au niveau de l’écriture, c’est unique ce qu’elle fait, je n’ai jamais vu ça ailleurs. Elle parle comme elle écrit, elle est comme ça. Et même quand les gens ne comprennent pas tout, ils kiffent.”
Le zouk hybride, à l’image d’un art évolutif
Avec des productions différentes qui permettent au rappeur de poser plus facilement, des flows et un lexique à l’image de ceux du rap, le zouk que propose la pop urbaine peut facilement déstabiliser les puristes du genre (souvent antillais) qui y voient une réappropriation de leur culture. Un débat qui n’a pas lieu d’être pour le sociologue Buata Malela : “C’est le propre de l’expansion d’une musique ou d’un art. Quand il évolue et qu’il s’étend, il change !” La chanteuse Kim, qui fait partie des grandes influences des artistes de pop urbaine aujourd’hui, voit dans cette nouvelle forme de zouk une occasion pour les artistes antillais de se réapproprier leur culture : “Maintenant, il y a un retour du zouk, on en entend partout et c’est à nous, les Antillais de savoir nous infiltrer dans la brèche, de savoir exploiter ce retour là. Je ne vais pas dire qu’on est plus légitime à le faire parce que c’est notre musique, je pense que tout le monde peut faire du zouk. Mais on a l’occasion de la mettre en valeur et de participer à son renouveau, donc faisons-le !” Et c’est d’ailleurs ce que Kim fait puisque son dernier album Évidence, sorti en avril dernier, prend le virage d’un zouk codifié comme celui de la pop urbaine, avec la présence notable de deux rappeurs en featuring (Landy et Gazo). “Pour moi, ça a été très enrichissant de travailler avec des gens qui sont hors de la sphère zouk. Mélanger cette musique avec d’autres gens ça peut donner des mélanges super intéressants”, assure la chanteuse.
Seul bémol dans une industrie rap à l’affût des nouvelles tendances, l’aspect trendy du zouk selon Hardlevel : “C’est une stratégie de faire du zouk maintenant, les artistes et les compositeurs savent que ça va fonctionner. Du coup on se retrouve parfois avec des sons zouk dans lesquels tu sens cette volonté commerciale. Ces morceaux sont très souvent moyens. Tu sens en écoutant ça que les artistes ne sont pas vraiment touchés et intéressés par le zouk.” Dans un contexte où le zouk se trouve à la mode sans pour autant être mis en avant, l’important ce n’est pas vraiment de savoir qui en fait mais “de dire et de répéter d’où il vient. C’est à nous qui connaissons le zouk et plus largement aux Antilles de le faire en premier lieu.” martèle Orlane. Pour Gérald Désert, la transmission de cet héritage culturel qui manque aujourd’hui, passe avant tout “par des ouvrages, des émissions, des articles et du travail sociologique.” Plus vivant que jamais, le zouk n’attend finalement que d’être considéré à sa juste valeur, celle d’une musique populaire, noble et surtout influente : toutes les qualités d’un roi. Un roi dont on ne peut plus, aujourd’hui, cacher la couronne.