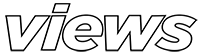« 5 téléphones, 5 L … morning routine sur SNKRS ». Un nouveau jour, une nouvelle paire et une nouvelle désillusion. On ne les compte plus. Cela ressemble à un schéma qui se répète sans cesse, une ritualisation à laquelle on a fini par prendre goût, malgré nous. Air Jordan 1 High “University Blue”, Nike Dunk Low SP “Syracuse”, Air Jordan 1 High “Dark Mocha”… À chaque sortie importante, le combat est le même. Dans le jeu de piraterie qu’est devenu le marché des sneakers, les chaussures sont des butins précieux réservés aux corsaires les plus aguerris.
Aujourd’hui, si t’es un passionné de sneakers, tu ne peux compter que sur ta chance ou sur un compte en banque très bien rempli. Si tu n’as ni l’un ni l’autre, tu n’auras pas ta paire.
Clément Molton, directeur de la boutique Footpatrol Paris
Le constat est amer mais pourtant bien réel : “Aujourd’hui, si t’es un passionné de sneakers, tu ne peux compter que sur ta chance ou un compte en banque très bien rempli. Si tu n’as ni l’un ni l’autre, tu n’auras pas ta paire”, tranche Clément Molton alias Clems (@clemshimself), directeur de la boutique Footpatrol Paris.
Conscients de cette réalité, les adeptes de la basket se sont rassemblés autour d’une idée simple : le L. Acronyme de “Loss” soit “l’échec,” “la défaite,” cette lettre condense toute la frustration (et parfois l’auto-dérision) du public autour de sa passion. Lorsque l’on ne parvient pas à obtenir une paire en édition limitée, que l’on perd une raffle (un tirage au sort pour gagner le droit d’acheter une paire), on prend un L. Cette culture de la défaite commune est aujourd’hui si ancrée dans la culture sneakers, qu’elle est devenue la base d’un compte Instagram parodique à près de 35 000 abonnés comme celui de @temalapaire. « Ce qui m’attriste le plus aujourd’hui, c’est de voir que les jeunes générations sont vraiment affectées par les “L” » nous explique-t-il, désireux de relativiser ce problème. Malheureusement, tous n’ont pas son recul.
Une culture consumée par l’appât du gain
Il y a encore quelques années, on pouvait apercevoir aux abords des boutiques telles que Colette, Opium ou encore Sneakernstuff, une multitude de sneakerheads s’agglutiner, dans l’attente d’obtenir le Saint Graal. Les “camp out,” soit le fait de faire la queue devant un magasin pour y acheter une sneaker rare, paraissent aujourd’hui d’un autre temps. Véritables lieux de rendez-vous des passionnés, ils étaient pour beaucoup une sorte de terrain de sociabilité. “Quand on décidait de camper, c’était plus pour passer du temps entre potes que par réelle nécessité”, affirme Clems.
Toutefois, l’ambiance bon enfant n’avait malheureusement rien d’universelle. Aux États-Unis tout particulièrement, les anecdotes liées à des dérapages ne manquent pas. En 2005, dans le cadre d’une collaboration avec Nike autour de quatre Dunk Low, le designer Jeff Staple sortait une version “Pigeon” de la chaussure dédiée à New York. Distribuée à seulement 150 exemplaires dans la boutique Reed Space, la sneaker causa alors une émeute tant les campeurs étaient nettement plus nombreux que les quantités disponibles. De plus, des gens armés de couteaux et de battes de baseball attendaient dans la rue, dans l’unique but de racketter les détenteurs de la fameuse Dunk Low de Jeff Staple, aujourd’hui estimée à plus de 15 000€. La police avait été obligée d’escorter les clients pour éviter un drame. Ce camp-out est dès lors devenu le symbole des débordements parfois scandaleux que certains drops pouvaient engendrer. Les marques ont donc réagi en mettant en place des systèmes de tirage au sort en ligne, les fameuses raffles.
Popularisée par Supreme, la raffle a été réutilisée pour les sneakers lors de la collaboration entre Kanye West et adidas, à l’occasion des différentes sorties YEEZY. Pourtant, c’est en novembre 2017 que le phénomène se cristallise, avec le duo évènement Nike x Virgil Abloh sur la série “The Ten”, dont l’ensemble des baskets n’ont été rendues disponibles que par le biais de tirages au sort en ligne. Si les camp-out, malgré leurs problèmes, avaient le mérite de reposer sur le concept de “premier arrivé, premier servi”, l’achat de sneakers va très vite perdre sa notion de méritocratie.

Bien que les drops conservent l’idée que le plus rapide l’emporte, comme c’est le cas sur SNKRS, la technologie s’est chargée de tout chambouler. Des stratagèmes ont été mis en place dans le but d’automatiser l’achat de sneakers en édition limitée. Communément appelés bots, ces programmes, du fait de leur rapidité, garantissent à leurs utilisateurs une quasi-exclusivité permanente.
Les bots fonctionnent selon un système très simple, accessible à tous. Lorsque l’on tente d’acheter une sneaker, il est nécessaire d’indiquer ses informations essentielles telles que la taille, le mode de paiement, mais aussi valider les informations de livraison. Le bot fonctionne alors comme une machine programmée où l’on rentre toutes ces informations au préalable, ce dernier se chargeant d’automatiser l’achat au moment de la commande. De quoi gagner de précieuses secondes, voire même des minutes, qui font souvent la différence entre un achat réussi et un échec. Pour autant, ce service est loin d’être gratuit étant donné le profit qu’il peut engendrer à moyen et long terme. Le réputé AIO BOT V2 est par exemple disponible à 325 dollars, tandis que d’autres fonctionnent par abonnement. Ce dernier se revendique être “le meilleur bot sneaker” et d’avoir permis la validation de “300 000 commandes“. En clair, d’être une machine à cash à portée de clic.

Cette technique est évidemment révoltante pour beaucoup de fans ne souhaitant pas jouer le jeu de la course aux bots, puisque le combat devient alors complètement déloyal. Les camp out pouvaient engendrer des défaites à la régulière, si l’on arrivait par exemple en retard. Ici, les gens perdent face à des algorithmes, de quoi créer de la frustration. Cette robotisation d’un marché difficilement régulable, très élaborée pour déjouer les systèmes de détection, est alors semblable à des armes infaillibles à chaque drop. Les bots occupent donc une place prépondérante au sein d’une économie parallèle qui s’est construite ces dernières années.
Le resell et les bots sont juste les conséquences des mécanismes de marché entre l’offre et la demande.
Temalapaire
La revente a toujours été une composante inhérente à cette culture, contrôlée par des principes qui étaient toutefois plus proches du troc et de la notion d’échanges humain, entre passionnés. Aujourd’hui, le resell s’apparente davantage à un sport solitaire sans règle définie. Le récent scandale autour de l’ancienne vice-présidente en charge de la région Amérique du Nord de Nike, Ann Herbert, et de son fils pratiquant le resell, illustre bien les rouages d’un système à la dérive.
En dehors des circuits de distribution classiques, les prix des baskets fluctuent en fonction de l’offre et de la demande, à l’instar d’une place boursière. “Le resell et les bots sont juste les conséquences des mécanismes de marché entre l’offre et la demande. C’est le résultat inévitable à la fois de la stratégie des marques, mais aussi de la demande exponentielle liée à l’explosion de la sneakers culture”, note Temalapaire (@temalapaire). La resell a ainsi créé une segmentation du marché, désormais polarisé autour de plateformes de e-commerce proposant un large panel de sneakers.
Parmi la panoplie de sites de revente qui ont vu le jour ces dernières années, StockX, fondé en 2016, s’est incontestablement imposé comme la clef de voûte de tout un business. Plus qu’un leader de marché, StockX est surtout une révolution dans le resell de sneakers. Au-delà de vendre des paires, la plateforme définit aujourd’hui la valeur d’un modèle, de sa taille et de son coloris, transformant les sneakers en un véritable actif financier. Pour revendre une paire il y a dix ans, il fallait quasiment être un expert pour bien le faire. Aujourd’hui, n’importe qui peut connaître la valeur d’un modèle en quelques secondes, puisque celle affichée sur StockX sera pratiquement la même partout. L’entreprise américaine est devenue la bourse des sneakers, et a définitivement boulversé le marché de la revente. En témoigne cette infographie réalisée par Statista, où l’on constate que le volume total des transactions sur StockX a atteint pour la première fois le seuil du milliard de dollars en 2019, et a presque doublé en un an seulement.

Plus largement, selon le cabinet Cowen & Co, le marché du resell pourrait atteindre 6 milliards de dollars d’ici 5 ans. Des chiffres exorbitants, d’autant que la plus grosse sphère d’influence du marché est hors numérique. Mais comment expliquer un tel engouement ? Le passage d’une culture de niche à une culture de masse ne s’est pas fait en un claquement de doigts, comme le souligne Clems: « Pour moi, la street-culture au sens large est devenue la pop culture d’aujourd’hui. Le rap et le hip-hop sont les musiques les plus écoutées dans le monde aujourd’hui, et des sports tel que le basket ont gagné le public outre-Atlantique. Les artistes d’art contemporain comme KAWS et Takashi Murakami, qui sont issus de la street-culture à la base, sont devenus mainstream. » Pour Temalapaire, « la sneakers culture s’inscrit dans une révolution culturelle globale […] Elle a largement dépassé les sneakerheads des années 1990/2000.»
Ce sont pourtant bien les fans historiques qui pâtissent le plus de ces nouvelles règles du jeu. « Je pense que les marques ne s’en soucient même pas, car même s’ils ne sont plus aussi concernés qu’avant, ils seront toujours là, ils suivront toujours, de près ou de loin. À part les plus connus et ceux qui ont des milliers d’abonnés sur Instagram, les marques ne s’occupent que des influenceurs actuels, pas des puristes avec 300 followers qui achètent des Jordan depuis 30 ans. », ajoute-t-il.
Les marques ne s’occupent que des influenceurs actuels, pas des puristes avec trois cent followers qui achètent des Jordan depuis 30 ans.
Temalapaire
En réaction, certains sneakerheads récalcitrants s’organisent pour tenter de contrer le système de raffles et la domination des bots, devenu un problème abyssal. Dirigée par Dejan Pralica et Justin Dusanj, qui ont lancé l’entreprise en 2018, SoleSavy est une plateforme de commerce en ligne anti-bot, qui a vocation à raviver l’esprit communautaire. Un point de vue qui gagne de plus en plus de terrain. Selon Clems, une solution à ce problème serait de « rétablir l’égalité des chances d’accès aux paires en favorisant le service client, les personnes fidèles qui viennent soutenir le business pas uniquement le temps d’une collab’. » En d’autres termes, revaloriser les vrais passionnés, redistribuer les cartes et réhabiliter la sneaker culture d’une forme de “mérite” disparu.
Si pour l’heure, cette résolution a tout l’air d’une lubie, le remède pourrait venir directement des marques. À la suite du scandale de la famille Hebert, John Donahoe, le PDG de Nike, a apporté un élément de réponse qui pourrait bien redonner de l’espoir à certains clients. « On travaille sur une technologie anti-bot depuis quelques années (…) Ça fait partie de la solution, mais on se doit de redoubler d’efforts » explique-t-il. Une réaction certes mesurée, mais qui pourrait servir de point d’amorce au débat, puisque c’est la première fois qu’un géant du secteur s’exprime aussi explicitement sur la question de la revente et des bots.
Le marketing de la frustration comme stratégie de marque
Avec la démocratisation des sneakers, les enseignes de sportswear — avec Nike et adidas en chef de fil — ont très vite compris qu’elles étaient au coeur d’une manne financière exceptionnelle. Derrière toutes les attentions des marques pour accompagner le client, un seul objectif réside en toile de fond : vendre le plus possible et générer davantage de profits. Dans les faits, il s’agit de concevoir des produits pour lesquels la demande est très élevée, en dépit d’une faible production. Les marques abreuvent le marché de collaborations et éditions limitées en tout genre, de manière à créer un phénomène de hype, qui peut se résumer par l’attente et le désir du public pour un produit. La pénurie engendrée aboutit à la création d’une forme de dépendance pernicieuse, voire une addiction.
La stratégie des marques consistant à proposer des paires très attendues en petites quantités peut surprendre au premier abord. Instinctivement, la logique voudrait qu’elles vendent de grandes quantités, combler tous les clients et ainsi gagner le plus d’argent. Mais cette frustration crée un désir qui se propage à toute la marque, pas seulement à un ou deux modèles et coloris. Dès lors, des Air Jordan Mid ou des coloris très peu populaires de Dunk High se retrouvent également sold-out en quelques instants.
Sans cette stratégie, Nike ne pourrait pas écouler ces modèles de seconde zone comme elle le fait actuellement. SNRKS devient alors une plateforme virale, un flux financier immense et intense qui ne s’arrête jamais. Le désir provoqué par le marketing de frustration fait aujourd’hui absolument tout vendre, et Nike en tire profit en proposant de nouveaux coloris tous les jours. Après tout, un public peu initié et frappé par la hype achètera sans réfléchir, même lorsqu’il s’agit d’un modèle qui n’avait aucune désirabilité quelques années auparavant.
Aujourd’hui, pour un ado de 15 ans, acheter une paire à 500 euros est devenu la norme.
Clément Molton, directeur de la boutique Footpatrol Paris
Les avis divergent au sein de la communauté quant à cette stratégie de marque. Pour Alexandre alias La Routine (@laroutineyt), Youtubeur spécialisé dans le streetwear, « La difficulté [à cop des paires] ne se transforme quasiment jamais en frustration, pour la bonne et simple raison que des belles paires sortent à la pelle chaque mois aujourd’hui… La possibilité de retenter sa chance n’est jamais bien loin, ils sont forts. » De son côté, Temalapaire s’érige davantage en porte-parole des plus sceptiques: « Les marques sont en train de créer des clivages dans cette culture et c’est la jeunesse qui va en payer le prix. Certains ont le recul pour relativiser, mais on n’enseigne pas le déchiffrage des messages marketing et les stratégies commerciales en primaire et au collège. »
Ce qui est avant tout pointé du doigt est le manque d’information de la part d’un public jeune et néophyte, qui doit souvent se confronter à un jargon spécifique et un savoir difficile à obtenir. « Aujourd’hui, pour un ado de 15 ans, acheter une paire à 500 euros est devenu la norme. En boutique, quand ils voient le prix d’une Yeezy à 220 euros, ils sont choqués, car pour eux, ça vaut forcément plus cher. Le problème est qu’ils ne font pas la différence entre ‘retail’ et ‘resell.’ Il y a une sorte de brouillage des cartes » s’indigne Clems. Cependant, est-ce véritablement un rôle qui incombe aux marques que d’introniser des processus pédagogiques au service des consommateurs ? Pour Temalapaire : “Qui dit grand public dit aussi amateurisme, et il y a un réel devoir d’éducation de la part des acteurs installés. Beaucoup de charlatans profitent de l’ignorance de certains, comme on peut le voir avec les pseudo-resellers de Vinted ou des sites de contrefaçons en tout genre.”
Globalement, si ce marketing de frustration apparaît aujourd’hui comme l’ennemi du public, Temalapaire invite à relativiser ce sentiment : “Bien sûr je suis déçu quand je ne peux pas cliquer une paire mais la vraie question c’est : est-ce que je la voudrais autant si elle n’était pas si rare ?“
Nouveau luxe et impact des réseaux sociaux
Au-delà d’une démocratisation, l’objet qu’est la basket s’est véritablement “glamourisé.” Emblèmes originels de la contre-culture, les sneakers ont pris la forme d’accessoires de luxe revisités par une multitude de grandes maisons. De Balenciaga à Gucci en passant par Dior, le streetwear s’est imposé comme un « must have », une manière de moderniser leur image et surtout de séduire une clientèle plus large. Conscientes du marché juteux que représente l’industrie de la sneaker, les griffes tablent sur des investissements et des budgets marketing toujours plus importants.
La nomination de plusieurs directeurs artistiques issus du milieu du streetwear à la tête de ces institutions est symptomatique de cette mouvance. Virgil Abloh (Louis Vuitton), Kim Jones (Dior) ou encore Matthew Williams (Givenchy) : ces spécialistes ont intégré les hautes sphères de la mode pour la révolutionner intrinsèquement. Et si ce virage culturel global peut être perçu comme une dénaturation de la street-culture, « démocratiser un mouvement n’est pas forcément le détruire » affirme La Routine.

L’impact positif ou négatif des marques de luxe sur l’échiquier de la sneaker peut être discuté, mais il est en tout cas symbolisé par une période bien précise : octobre 2015. Cette dernière correspond à l’arrivée de Demna Gvasalia à la tête de Balenciaga. Avec la Triple S, le designer révolutionne le marché des baskets de luxe en créant un modèle qui a grandement aidé la griffe française à atteindre le milliard d’euros de revenus pour la première fois en 2019. Dès lors, les concurrents ont eux aussi emboité le pas : Prada et sa “Cloudbust”, Louis Vuitton et sa “Archlight”, Gucci et sa “SEGA”, Versace et sa “Chain Reaction” en collaboration avec 2 Chainz ou encore Margiela et son modèle “Fusion” recouvert de colle. Symbole de cet intérêt collectif, les ventes de sneakers de luxe ont augmenté de 50% entre 2017 et 2018.
Dans le meilleur des mondes, Instagram devrait nous aider à être libres et à nous exprimer. Mais dans la vraie vie, il nous transforme en “ienclis” écervelés.
@temalapaire
Il est indéniable qu’une partie de la popularité nouvelle des baskets est donc liée à un fort aspect économique. Pour autant, d’autres facteurs doivent être pris en compte pour comprendre ce phénomène dans son entièreté. Au sein d’une société où l’usage des réseaux sociaux est devenu une norme sociale, Instagram occupe une place prédominante. Le réseau est au cœur du processus de mutation d’une culture sneaker « classique » (acquisition de l’objet à des fins personnelles) à une culture sneaker axée sur l’image. « Maintenant, les gens achètent une paire pour faire une belle photo, pas pour la rocker » constate Tema la paire.
« Instagram façonne notre opinion et qu’on le veuille ou non, les images que l’algorithme nous montre sculptent notre esprit critique. Dans le meilleur des mondes, Instagram devrait nous aider à être libres et à nous exprimer, mais dans la vraie vie, il nous transforme en “ienclis” écervelés ». Une idée renforcée pour le YouTubeur La Routine, qui voit Instagram comme « l’un des moteurs principaux de cette évolution, avec une utilisation principale autour de l’image, de plus en plus centrée autour de soi d’ailleurs. »
En conséquence, se développe un risque de dépersonnalisation qui tend à se généraliser ainsi qu’une uniformisation des identités. À l’origine de la culture sneaker, c’était pourtant l’inverse qui était recherché par ses adeptes, comme le rappelle Clems: « Moi à la base, si je me suis intéressé à cette culture, c’est parce que je voulais me différencier. Aujourd’hui c’est le contraire, tout le monde veut être pareil, avoir la même paire, le même produit. » Ce phénomène est surtout développé par les influenceurs qui, par leur exposition médiatique et leur nombre d’abonnés, jouent un rôle majeur dans la stratégie marketing des enseignes et l’ouverture à un nouveau public, souvent mal informé.
Lorsque Lena Situations réalise un concours sur son compte Instagram qui monte à 600 000 commentaires, dans le but de faire gagner 5 000€ de sneakers, elle touche un public qui n’est habituellement que peu concerné par les dernières tendances en la matière. Dernièrement, la candidate de télé-réalité Maddy Burciaga a été moquée pour avoir complètement raté la promo d’une sneaker : « Récemment j’ai reçu ma paire de Jordan 1 Pastelle, j’adore les baskets » explique-t-elle en tenant dans les mains… une paire d’Air Force 1. Si l’anecdote fait forcément sourire, elle est symptomatique de arrivée massive d’un nouveau public, qui bouscule complètement une industrie, sans pour autant chercher à en maîtriser les codes.
Si des sneakers Nike peuvent apparaître à leurs yeux comme un nouveau produit glamour, voire de luxe, c’est bien parce que le resell a transformé la vision du produit. Dans l’imaginaire collectif, une collaboration entre sacai et la marque au swoosh correspond à un modèle qui va coûter 400, 500 ou même 600€ du fait de sa rareté, de sa demande et de la difficulté à l’obtenir au retail. Dès lors, la sneaker se classe dans la gamme de prix des produits qui attirent les gens aisés et les célébrités. Quand ce nouveau public voit la Dior x Air Jordan 1, il perçoit l’ultime objet de luxe qu’il faut avoir, peu importe qu’il faille dépenser 10 000 €. Quand bien même la base de ce produit n’est qu’une chaussure de basket-ball à des années lumières de la haute-couture.
La finalité est qu’aujourd’hui, l’aspect économique et glamour de la sneaker est largement plus attrayant que l’aspect culturel pour le grand public. À tel point que l’on va collectivement se contenter de regarder ce qui se vend et ce qui ne se vend pas, ce qui engage et ce qui n’engage pas, sans réel intérêt pour l’histoire qui se cache derrière l’objet. Ce constat est le résultat direct de l’intense démocratisation des sneakers ces dernières années. Cette culture appartient désormais à tout le monde. C’est un fait, elle n’est plus le trésor chéri par une poignée d’initiés, elle est maintenant un mouvement global ancré dans la pop-culture, tout comme l’est aussi devenu le rap.
Dans cette impression générale qui peut sembler très négative, Temalapaire note tout de même du positif : « La masse permet à beaucoup d’acteurs de cette culture d’en vivre confortablement et de se développer, que ce soit des médias, aux influenceurs en passant par les créatifs et les marques. » D’autres pointent du doigt des priorités qui sont finalement ailleurs. C’est le cas de La Routine, qui nous explique souhaiter : « Une plus grande transparence quant à la provenance des paires et de leur production (…). En tant que grand consommateur, j’ai souvent une forme de culpabilité liée à ça. » De quoi ne pas perdre de vue que des combats bien plus importants attendent cette industrie, et ils ne seront pas menés sur SNKRS.
Merci à nos intervenants Clément Molton, Temalapaire et La Routine.