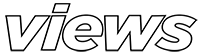Tout est noir
Quand Cardi B prend la parole, elle le fait rarement à demi-mot. S’exprimant sur la soi-disant faible proportion de titres taillés pour le club dans le paysage rap actuel, elle pousse un coup de gueule pendant un Live Instagram : “J’ai l’impression d’entendre la même chanson encore et encore […] Tout ce que veulent ces rappeurs, c’est mourir”.

L’époque serait-elle à la tristesse ?
Il y a eu, dans la grande histoire du hip-hop, mille périodes et mouvements. Ils ont été parfois durs comme un froncement de sourcil menaçant, parfois légers comme un sample de disco, élégants comme des notes de jazz, ou relaxants comme une boucle de funk ralentie, qui servirait de bande-son à des virées sur les routes ensoleillées de la Californie. Jusqu’à ce que les ténèbres couvrent tout. La donne n’est pas nouvelle : dans les années quatre-vingt-dix, 2Pac voyait la mort “au coin de la rue”, Notorious B.I.G dévoilait ses “pensées suicidaires”, pendant que les Geto Boys avouaient que leurs esprits étaient en train de dérailler. La donne n’est pas nouvelle, mais elle n’était jusque-là pas une norme.
Ces dernières années, la noirceur ne s’est pas cantonnée à quelques rares exemples. Elle a enveloppé des artistes qui l’ont chantée pour que le monde entier puisse la sentir. Lil Durk, Future, YoungBoy Never Broke Again, Kodak Black, Polo G, Lil Baby, Kevin Gates, Morray, Lil Tjay, Bino Rideaux et tant d’autres font partie des têtes d’affiches de la musique Outre-Atlantique et produisent une musique profondément sombre et repliée sur elle-même, qui, paradoxalement, se couvre de lumière en générant des millions de streams et de dollars. Et puisque tout semble condamné à se répéter, un genre, pourtant loin des canons de l’industrie du disque, refait surface : le blues, avec ses récits de solitude et d’amour brisé.
En 2021, le rap se lamente,
et son écho est terrifiant.
Gates & Wave
Baton Rouge : proche de la Nouvelle-Orléans. Le Sud des Etats-Unis, où l’atmosphère est poisseuse, les routes longées par des marécages, et où, souvent, les éléments se rebellent et emportent tout sur leur passage. La région est particulièrement féconde : la Louisiane a fait sonner dans tout le pays des échos du jazz, de la musique créole, de la soul, du blues et du rap, puisqu’elle a vu naître les Lil Wayne, Webbie, Master P, C-Murder, Juvenile, Mia X et autres Soulja Slim. Là-bas, les dents sont en or, les rythmes sont ralentis et les danses sont lascives. On chante beaucoup, aussi, en Louisiane. La fête prend de multiples allures. Logique, dans ce contexte, qu’un homme comme Boosie, anciennement Boosie Badazz, ait réussi à se frayer un chemin sur la scène locale, avec son habile mélange d’histoires de rue et ce flow à la fois traînant et saccadé qui flirte avec le chant. Charismatique et à l’aise sur plusieurs registres, l’homme est aussi sulfureux, tout entier habité par son personnage, et côtoie l’inacceptable. Mais il faut lui reconnaître sa longévité exemplaire et son impact sur toute une génération de rappeurs. Parmi eux : MO3, récemment assassiné sur une autoroute alors qu’il tentait d’échapper à son assaillant, et dont la musique est parfois si violente et torturée qu’elle en devient difficile à supporter – « One Of Them Days Again », « Broken Hearted » – mais aussi et surtout Kevin Gates.

Lui aussi associé à Baton Rouge, l’homme aux « Deux téléphones » a traversé les années 2010 en soliste, en faisant traîner sa voix gutturale, qui semble partir des tréfonds de son âme. Sur la pochette de son premier album, Islah, il fait mine de pointer une arme sur sa tempe, et se montre tour à tour paranoïaque et violent, vulnérable et le cœur plein d’amour. Même si le club n’était jamais loin, avec Kevin Gates, rarement le rap n’a été si replié sur les tourments de son interprète, à ce point tiraillé entre les extrêmes, se jouant des genres pour faire exploser les barrières stylistiques.
J’ai l’impression d’entendre la même chanson encore et encore (…)
Tout ce que veulent ces rappeurs, c’est mourir.
Et quel autre endroit que la Louisiane, à quelques encablures de la Nouvelle-Orléans, pour faire naître cet hybride ? La ville elle-même a toujours eu les frontières en horreur.
Des années après son émergence, Gates permettra à Rod Wave, l’archétype de l’artiste des années 2020, de s’exprimer à grande échelle. Wave avait certes grandi en étudiant le débit loufoque et technique d’E-40, qui, au début des années quatre-vingt-dix, avait amorcé une petite révolution dans la manière de rapper, mais s’était aussi nourri de la musique de Boosie et de Kevin Gates, avec qui il part en tournée et collabore. À l’écouter, difficile de savoir où le situer : est-il un rappeur, un chanteur de r’n’b, ou un bluesman ? Rod Wave revendique ces trois identités, en enchaînant les titres hantés par les fantômes de son passé, ceux qu’il craint quand il pense à l’avenir et toutes les choses qui le tirent vers le bas. Il y a quelque chose de fascinant à le voir, lui et Morray, son homologue de Caroline du Nord et au positionnement similaire, accumuler les millions de vues sur YouTube : l’époque est à l’introspection, aux hommes qui, comme Rod Wave chantonnent en parlant de leur pierre tombale (“Thombstone”). Même le r’n’b change de camp : à l’Ouest, Bino Rideaux, protégé de feu Nipsey Hussle chante le spleen d’un homme affilié au gang des Crips, et dont les proches partent les uns après les autres, alors que Bryson Tiller et 6LACK ne cachent rien de leurs faiblesses et s’éloignent des textes centrés autour du sexe et de l’amour que le r’n’b a brillamment traités.
Amour maudit
Avant eux, Future, avec sa voix éraillée et ses hymnes sous codéine, avait tout de l’homme qui exposait ses vices pour les exorciser, tout en étant conscient qu’il lui était difficile de s’en défaire. Quand il pose sur « East Atlanta Love Letter » avec 6LACK, il paraît dépité d’écrire ce qui aurait dû être une lettre d’amour à l’endroit qui l’a vu grandir. Chez Future, l’amour est rarement léger et sans tourments, il est fait de trahisons, de tromperies et ne dure jamais longtemps. Forcément : il y a trop de tentations et le diable est derrière chaque cambrure. Future est une présence charismatique, un homme aux mélodies qui font vibrer les boîtes de strip-tease puis servent de bande-son à ceux qui s’autorisent un dernier verre après la fête, tristes comme un comptoir déserté.
Il faut dire qu’il est issu du donjon le plus connu d’Atlanta, la Dungeon Family, terre des exploits d’Outkast et des Organized Konfusion, où le rap, funk, la soul et le blues se mélangeaient dans le sous-sol d’une maison familiale, dans une petite pièce sentant la sueur et les esprits en ébullition. Future a fait voler tout cela en éclat, empruntant moins à la soul et au gospel que ses mentors, mais en gardant cette noirceur que le blues a tant de fois exprimé. Pas étonnant que sur l’album Pluto x Baby Pluto, il s’associe à Lil Uzi Vert, génie incompris autoproclamé et personnage aussi excentrique que loufoque, parfois au bord de l’autodestruction, qui semble cacher son mal-être en multipliant les excentricités. Mais même la force du collectif n’arrive pas à faire sortir Future de ses tourments : sur “Rockstar Chainz”, après s’être vanté – comme souvent, avec lui – d’avoir couché avec les petites-amies de ses ennemis, il justifie son comportement en avouant qu’il a “laissé [son] coeur dans la rue”. Toxique jusqu’au bout des ongles.
Et à l’image du bluesman John Lee Hooker, qui, lui aussi, ajoutait des nuances subtiles à son chant, préfigurant le rap en parlant pendant ses chansons, Future accorde autant d’importance aux rythmes sur lesquels il pose, qu’à la manière dont il raconte ses histoires. Chez lui, comme chez les bluesmen, le sexe et Satan sont omniprésents, et quand il rappe – ou chante, la frontière est devenue presque invisible – c’est en ne retenant rien et en dévoilant tous ses tourments – « Codeine Crazy » -.
Le Rap devient viscéral et vulnérable, en conservant tout de même son arrogance. Conway, rappeur du label Griselda, exprimait bien ces sentiments sur « Clarity » : « Got all this ice on my chest to go with my cold heart / J’ai toute cette glace – des bijoux – sur ma poitrine pour aller avec mon cœur froid ».

Kanye, abattu
Même le Gospel, cette musique qui rassemble, se chante avec le cœur et donne de l’espoir, prend des allures de chemin de croix. Jamais le dernier lorsqu’il faut célébrer son amour pour Dieu, Kanye West lui-même, sur son dernier album, s’avoue vaincu. « 24 », une des synthèses les plus réussies entre rap et gospel de sa carrière, commence avec un chœur implorant « Cher Dieu, arrange tout, seul toi peut tout arranger / Cher Seigneur, arrange tout, jamais rien ne va comme il faut », avant que Kanye ne prononce le mot « fatigué » en début de couplet.
Il semble épuisé, comme s’il n’avait d’autre choix que de s’en remettre à une entité divine pour se soulager de ses tourments.
Cher Dieu, arrange tout, seul toi peut tout arranger.
Cher Seigneur, arrange tout, jamais rien ne va comme il faut.
Kanye West sur “24”
Le gospel, une musique qui flirte avec le désespoir ? Impensable il y a quelques décennies, et pourtant. La musique a toujours été le reflet de son époque : les exemples sont nombreux. Le blues était devenu plus électrique, plus libéré, en se frottant aux villes industrielles du Nord, après s’être éloigné du Delta du Mississippi et des États ségrégationnistes du Sud, mais il n’avait pas pour autant oublié ses origines. Dans les années soixante, la soul était harmonieuse et positive, elle chantait des jours meilleurs à mesure que le mouvement des droits civiques faisait filtrer un peu de lumière derrière la grisaille. Puis le Pasteur King s’est fait assassiner, et la musique a changé de cap. La soul pleine d’espoir de Curtis Mayfield, un homme dont l’impact sur le rap a été considérable, s’est alors teintée de funk et de psychédélisme. « S’il y a un enfer en dessous, on va tous y aller », chantait-il.
Le rap, lui, a suivi aussi une évolution similaire, faisant écho à une société qui laisse peu de place à l’apaisement. Il est plus que jamais, à des hauts niveaux d’exposition médiatique, paranoïaque, et conscient que tout peut s’arrêter.
La fin rôde partout
Mais pourquoi tout doit-il être aussi sombre ? A quel moment tout a déraillé et depuis quand la tristesse est-elle devenue la norme ? Difficile à dire. Après l’espoir Obama et la désillusion Trump, les Etats-Unis ont vu la liste des noms des personnes tuées par des policiers s’allonger, comme si aucune plaie ne pouvait jamais cicatriser. L’histoire se répète, le désenchantement s’infiltre et s’installe sans crier gare, et les artistes qui embrassent ce changement trouvent un écho particulier auprès de leurs auditeurs. Serait-ce dû à l’omniprésence de la lean, souvent pointée du doigt ? Là aussi, compliqué de tirer une conclusion définitive, même si des études universitaires ont mis en avant les liens étroits entre le rap et cette drogue.
S’il y a un enfer en dessous, on va tous y aller.
Curtis Mayfield sur “If There’s a Hell Below, We’re All Going to Go”
La fin rôde partout, derrière les balles et les corps de policiers racistes, derrière les armes de rivaux, ou derrière des drogues mal dosées. Les disparitions brutales de plusieurs artistes au sommet de leur carrière, au rang desquels Pop Smoke, Juice WRLD, MO3, DMX, Mac Miller, XXXTentacion, DMX, Young Dolph, King Von, et tant d’autres, semblent précipiter les pensées obscures de leurs homologues. Et alors que les discours sur l’importance de la santé mentale commencent enfin à se développer – notamment en France, via les initiatives nécessaires d’ISHA et de Shkyd – le rap hurle à la mort, tel le bluesman Howlin Wolf dans les années cinquante qui mimait le son d’un loup solitaire, en criant pour que l’amour revienne, ou comme Muddy Waters – « I Can’t Be Satisfied » – et Elmore James – « Done Somebody Wrong » –, tiraillés entre leurs tentations et l’envie d’être un homme bien.
Si le blues s’est souvent adressé à des puissances extérieures pour supporter le quotidien, le rap prend un chemin semblable pour exprimer le même mal être. C’est 42 Dugg qui demande à ce qu’on libère ses amis incarcérés – « Free Merey » – c’est Maxo Kream qui se plaint de ne pouvoir faire confiance à personne – « Cripstian » – c’est 704 Chop, ex-protégé de DaBaby qui prie pour que « les policiers ne [le] tuent pas pendant [qu’il a] les mains en l’air » – « In Need » – et c’est Boogie qui dépasse les clichés du rappeur de Compton et se montre en train de porter un cercueil, entouré de membres du gang des Pirus. Les rappeurs questionnent l’ « après », se perdent dans les sentiments suivant un décès, s’étendent sur les syndromes post traumatiques d’une enfance passée sous la menace d’un environnement dangereux, et sur la solitude de ceux qui assistent à trop d’enterrements. Moins dans le présent et l’action, la musique fait moins étalage de sa dureté. Lorsqu’elle le fait, elle questionne les conséquences de telles postures.

Des cris dans la ville du vent
Le chant devient, dans ce contexte, le socle sur lequel tout se bâtit. Il ne sert plus seulement de faire valoir, comme pour les rappeurs des années deux mille, qui y voyaient un moyen de flirter avec un auditorat plus large, invitant des artistes r’n’b à ajouter un peu de douceur à leurs récits. Il n’est plus pointé du doigt pour sa supposée fragilité, et bouscule les clichés de virilité dans lesquels se sont parfois vautrés certains artistes. La voix est replacée au centre de l’équation, et avec elle, les flows deviennent plus mélodieux. Les accords de guitare, minimalistes et si chers au Blues, sont omniprésents, tandis que les textes, eux, se rapprochent des abysses, et c’est tout un pan du rap qui s’en trouve bouleversé. Tout cela est cristallisé par l’identité artistique d’YoungBoy Never Broke Again, lui aussi venu de Baton Rouge, lui aussi influencé par Boosie et Kevin Gates, lui aussi en équilibre constant entre le mal, la prison, les trahisons et l’amour, lui aussi, enfin, adulé par des centaines de milliers de personnes, alors même qu’il semble ne pas savoir comment naviguer dans ce monde qui l’étouffe – « Ain’t Easy » –.
Les nouvelles idoles sont perdues.
Il ne s’agit plus, comme Drake le fait, de chanter ses déboires amoureux, mais plutôt de tenter de faire partir cette foutue peine. En France, le spleen de PNL a fait des remous, et aux Etats-Unis, c’est à Chicago que Lil Durk ramène tout aux fissures dessinées dans le béton.
Parce qu’au Sud de la Ville du Vent, le combat n’a jamais cessé d’être désespéré. À la drill magnétique de Chief Keef, s’est succédé le rap tout aussi violent de Lil Durk, mais il y a, entre les deux rappeurs, un monde d’écart dans la manière de raconter les mêmes histoires. Si le discours est similaire et prend pour source Chicago, avec tout ce que cela implique de décès, de gangs, de fusillades, de violence et de beauté, Durk semble être plus assagi que son homologue, chantant et regrettant non pas ses actions, mais tout ce qu’elles ont entraîné.
Le symbole de cette évolution est le dénouement de son album en commun avec Lil Baby, The Voice Of The Heroes, blockbuster réunissant deux des artistes les plus en vogue du moment. « Rich Of Pain », « Make It Out » et « Bruised Up », évoquent tour à tour leur ascension sociale, les épreuves par lesquelles ils sont passés et la peur de retourner d’où ils viennent. Les premières phrases et le titre de la chanson « Rich Of Pain », avec Rod Wave, semblent résumer à elles seules tout un pan du rap des années post-2010 : « Je suis parti de rien, mais ils vont quand même haïr / Ma vie entière m’a laissé des cicatrices, seuls les vrais peuvent savoir ça / Et je viens directement des tranchées, je suis sur le terrain tous les jours / Un jeune n**** parti de tout en bas, j’utilise mes larmes pour me motiver / Tellement de choses sont venues avec cet argent et cette notoriété / Mais je ne peux pas me plaindre ».
Je suis parti de rien, mais ils vont quand même haïr / Ma vie entière m’a laissé des cicatrices, seuls les vrais peuvent savoir ça / Et je viens directement des tranchées, je suis sur le terrain tous les jours / Un jeune n**** parti de tout en bas, j’utilise mes larmes pour me motiver.
Rod Wave sur “Rich of Pain”
Et alors on se prend à rêver que la lumière n’est peut-être pas si loin, et que même sous la voix d’artistes qui ont connu l’enfer, il reste toujours l’espoir que tout finisse par s’arranger. Pour cause, si le rap est aussi vivant aujourd’hui, si protéiforme et présent aux quatre coins du globe, c’est parce que les ténèbres finissent toujours par être chassés par la lumière. Que tout se réécrit et se réinvente, et surtout, qu’il y a de la place, dans une industrie globalisée, pour que toutes les nuances du rap puissent s’exprimer sur un pied d’égalité.
Le propre des musiques qui durent et rythment des combats ? Il paraît qu’après la bataille, les morts sont pleurés mais que les victoires sont aussi célébrées.
Nicolas Rogès
Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter