24 ans. Une éternité. C’est le temps qu’il a fallu pour mettre fin à la disette de victoires françaises en F1. La délivrance a été apportée par Pierre Gasly en septembre 2020 à Monza, glorieux successeur d’Olivier Panis à Monaco en 1996. Depuis, Pierre Gasly a rejoint Alpine pour s’ancrer dans un projet franco-français, où il défend les couleurs de la seule écurie tricolore du paddock, en compagnie d’un autre pilote Normand, Esteban Ocon. “Voir deux pilotes de la même génération arriver au top niveau de leur sport et se retrouver dans la seule écurie française, c’est une histoire digne de Hollywood“, raconte Pierre Gasly, qui ne cache pas ses ambitions de “vouloir faire d’Alpine une marque iconique“.
À l’occasion de la présentation de la nouvelle campagne Kappa x Alpine à Milan, le pilote français évoque pour Views son changement d’écurie, les ambitions d’Alpine ou encore les exigences de la performance en Formule 1.

On se rencontre à Monza, c’est dans cette ville que tu as gagné ton premier Grand Prix en 2020 et mis fin à 24 ans de disette française en F1. Quel est ton rapport à ce Grand Prix et plus généralement à cette ville ?
À Monza, je me sens un peu chez moi. Je vis ici, j’y passe beaucoup de temps. Ma victoire à Monza en 2020, ça a changé ma carrière et la manière dont je suis perçu dans le paddock. Ça a eu un gros impact sur ma vie professionnelle et même personnelle. Je n’oublierai jamais les émotions ce jour-là, en passant la ligne d’arrivée, les célébrations qui ont suivi.
Quel est ton bilan de la saison chez Alpine jusqu’ici et quelles sont tes ambitions pour les courses restantes ?
En termes de performances pures, on n’est pas au top. Mais comme on l’a montré à Monaco par exemple, on peut tirer notre épingle du jeu quand il y a des situations ou des contextes qui le permettent. L’ambition, c’est de marquer des points sur chaque course. Ça peut paraître banal, mais ce n’est pas quelque chose qui sera simple à obtenir. Il n’y a pas d’évolution prévue sur la voiture et on sait qu’il y a des concurrents très performants : Red Bull, Mercedes, Aston Martin, McLaren, Ferrari… Pour aller chercher des tops 10, il faut battre ces écuries. Et c’est tout sauf simple. On veut aussi apprendre le maximum pour préparer la voiture pour la saison prochaine.
Le PDG de Renault, Luca de Meo, a récemment déclaré son ambition de faire d’Alpine le “Ferrari français”. Que penses-tu de cette déclaration ?
Faire d’Alpine le Ferrari français, c’est très clairement le projet. On veut façonner une marque iconique, et continuer sur la lancée. La marque a été relancée il y a quelques années donc le chemin est encore long. Historiquement, Ferrari est la marque la plus importante dans notre sport. C’est un gros challenge, mais si on ne se fixe pas ce genre d’objectifs, pourquoi se lancer dans cette aventure ?
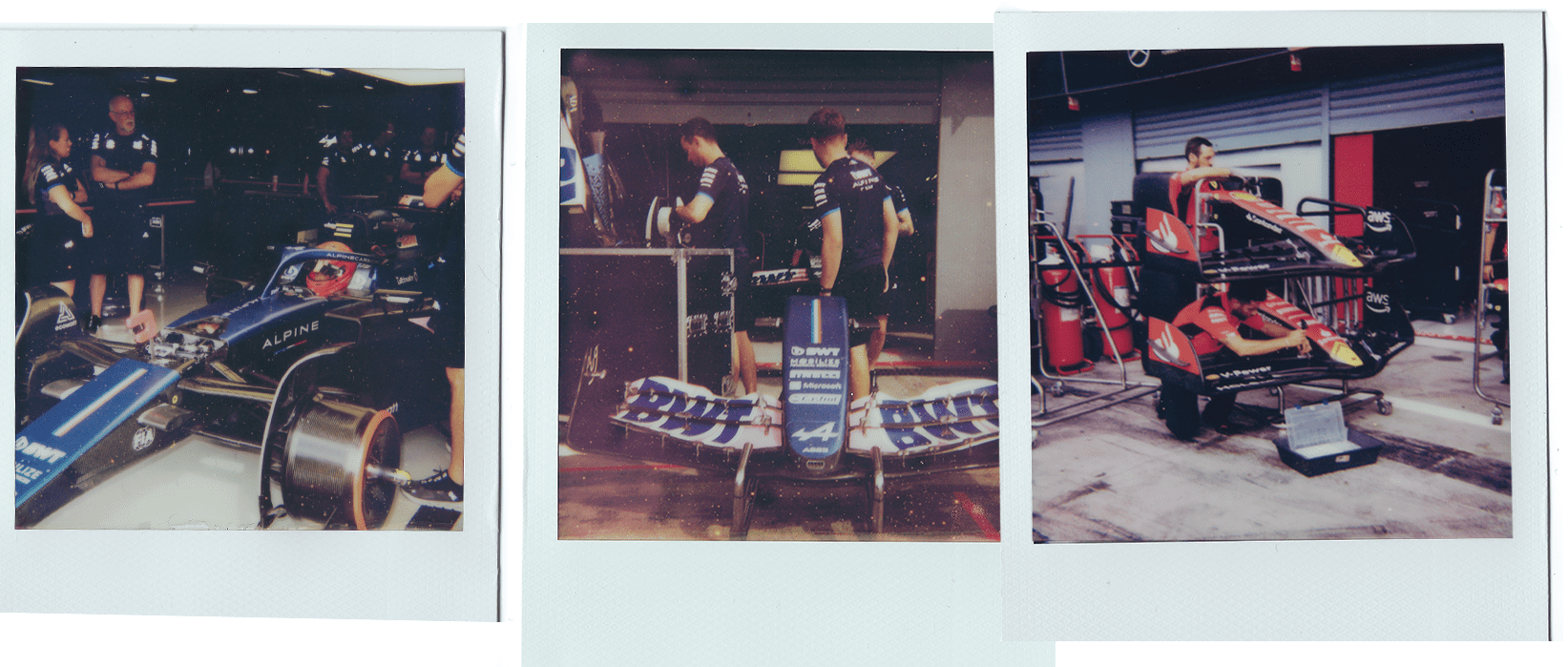
Outre une écurie française, ton coéquipier Esteban Ocon est également Français. Est-ce que ça a joué dans ta décision ?
Ça n’a pas profondément joué dans ma décision de rejoindre Alpine. Par contre, c’était un plus. Être le coéquipier d’Esteban, c’est une histoire incroyable et improbable. On vient tous les deux de Normandie, on s’entraînait étant gamins sur les mêmes tracés, au même moment. Je me souviens des mercredis après-midi ensemble et aujourd’hui, on se retrouve à se bagarrer avec Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen… Il n’y a pas eu de pilotes français en F1 pendant un moment, donc voir deux pilotes de la même génération arriver au top niveau de leur sport et se retrouver dans la seule écurie française, c’est une histoire digne de Hollywood.
Tu viens d’une famille qui baigne dans les sports automobiles. Comment ta passion pour ce sport a démarré ?
Ma passion pour les sports automobiles a débuté quand j’avais deux ans. J’étais en poussette et ma mère m’emmenait sur des circuits pour voir mes frères. Tu entends les moteurs, tu t’imprègnes de l’ambiance, ça m’a vite rendu accro. Le dimanche, il y avait une réunion de famille pour regarder la Formule 1 tous ensemble. Quand j’avais trois ans et demi, mon frère a obtenu un podium, je me souviens avoir touché son kart, son volant, je me demandais où était mon trophée à moi (rires). J’avais donc envie de tenter, de ressentir la sensation d’une course. J’ai démarré à six ans, mais j’ai arrêté pendant trois ans parce que mes parents ne pouvaient pas financer le coût d’une saison de karting. Ils m’ont dit de me concentrer sur l’école et que l’on verrait plus tard pour le kart. J’ai pu reprendre à neuf ans et je n’ai jamais arrêté.
Quand est-ce que tu as su que tu aurais une chance de courir en F1 ?
J’ai su que j’avais une chance en Formule 1 quand j’ai signé mon contrat chez Red Bull à 17 ans, quand j’ai gagné le championnat d’Europe en Formule Renault. J’avais un soutien qui me permettait de me développer et d’avoir une chance en F1 si mes résultats suivaient.
Comment s’est déroulée ton adaptation à la F1 ?
Je suis arrivé en F1 en 2015, j’ai commencé à être pilote de réserve pour Red Bull. J’ai pu me familiariser avec les méthodes de travail, l’environnement et l’équipe pendant un an et demi, avant de commencer avec Toro Rosso en Malaisie en 2017. La plus grosse c’est qu’il y a plus de 1 000 personnes qui travaillent dans une écurie de F1, alors qu’en Formule 2 il y a une trentaine de personnes. Les contacts avec les différents départements, les ingénieurs, sont beaucoup plus importants et plus précis.”
Comment est-ce que l’on gère la peur et la pression à ce niveau ?
J’ai appris avec le temps. Quand j’étais plus jeune, je ne la gérais pas aussi bien qu’aujourd’hui. J’ai géré le stress en m’entraînant beaucoup, en me préparant au maximum. Comme ça, au moment de monter dans la voiture, je sais que j’ai fait 100% du travail possible. Dans ce cas-là, je peux me dire que j’ai fait le maximum et qu’il n’y a donc pas de raison que ça se passe mal.
Lorsque l’on évoque le danger, le décès en course d’Anthoine Hubert a été un rappel cinglant des dangers de ce sport. Quel était ton rapport à Anthoine ?
Anthoine a toujours été l’un de mes meilleurs amis depuis tout jeune. On a évolué ensemble, depuis l’époque du kart où l’on était plus rivaux qu’amis proches. On partageait la piste ensemble, on voyageait partout en France pour courir. C’est quelqu’un qui était très rapide, que je respectais beaucoup. Il avait de l’intelligence et de belles valeurs. Au fil du temps, on s’est rapproché quand on est parti au Mans et qu’on a intégré l’internat et le pôle espoir. On a partagé la même chambre, le même appartement. On était dans la même classe pendant cinq ans et du matin au soir, on s’entraînait ensemble. On se poussait sur et en dehors de la piste pour devenir le meilleur.
Quel rapport as-tu au danger lors des courses ?
Quand on fait du sport automobile, le danger est quelque chose que l’on doit accepter. Ce n’est même plus quelque chose auquel on pense ou réfléchit. Si on pense au danger, on ne peut pas être aussi performant.
Comment tu expliquerais la difficulté d’une course en Formule 1 ?
En F1, tout est compliqué, aussi bien la partie physique que mentale. On roule à 350 kilomètres/heure pendant une heure et demie à la recherche du moindre centième ou millième de seconde. Même après avoir perdu jusqu’à quatre kilos en fin de course, il faut rester précis au centimètre près pour ne pas toucher un mur, rater son point de freinage et sortir. En plus de ça, on passe 60 à 70% du tour en apnée parce qu’on n’arrive pas à respirer pendant les zones de freinage et de virage. Physiquement, c’est éprouvant, et mentalement, on ne peut pas relâcher sa concentration une seule seconde.






